« La France se réindustrialise ». Tel est le mantra du pouvoir exécutif ces derniers mois, à coups d’annonces d’investissements étrangers en France avec des milliers d’emplois industriels à la clé ou de soutien public auprès de l’appareil productif. Pour QG, l’économiste Gabriel Colletis revient sur ces affirmations, et souligne au contraire la dépendance extrême de l’économie française à l’égard de l’étranger, en raison d’un tissu industriel dépecé depuis 30 ans et d’une absence de véritable politique industrielle. Interview par Jonathan Baudoin
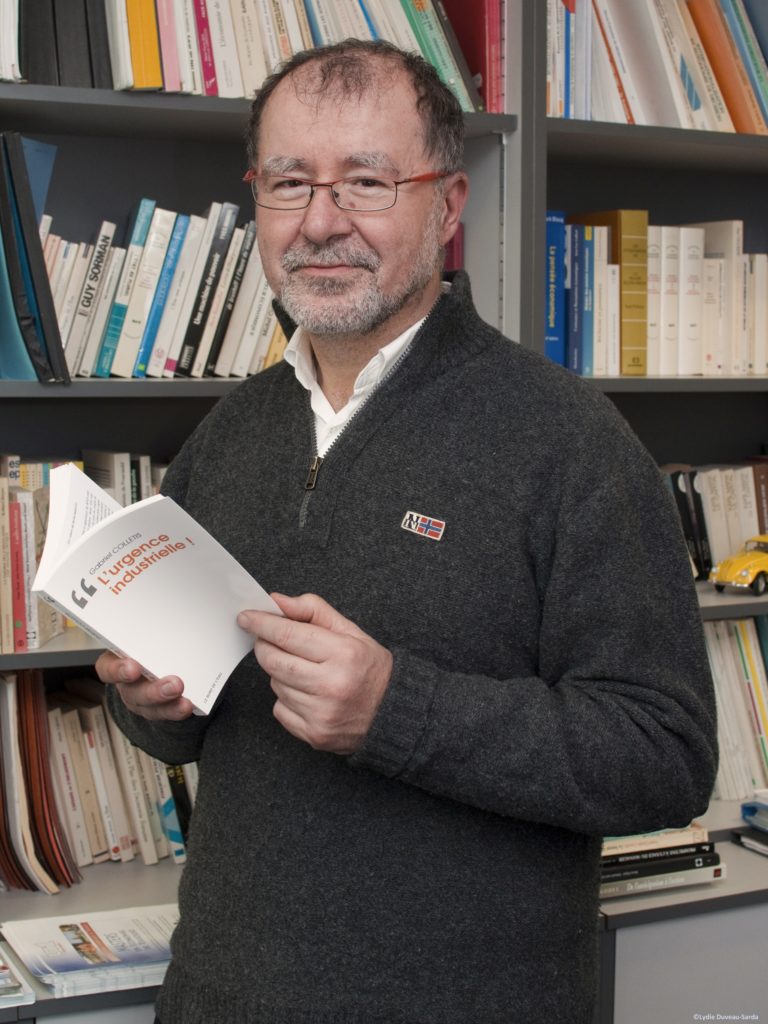
QG : Dans une interview accordée récemment au Point, Emmanuel Macron a affirmé que sa politique économique avait servi à préserver « l’appareil productif », notamment le secteur industriel. Il a aussi, en mai dernier, reçu de nombreux acteurs de l’économie pour « accélérer la réindustrialisation » du pays. Lors de son allocution ce jour-là, il a affirmé que 90.000 emplois industriels avaient été créés et près de 300 nouvelles usines implantées sur l’ensemble du territoire depuis 2017, assurant sa politique commençait à porter ses fruits après plus de 30 ans de désindustrialisation. Est-ce que les données statistiques confirment ou non une réindustrialisation de l’économie française sous la présidence Macron ?
Gabriel Colletis : La chose fait effectivement débat. Statistiquement parlant, l’érosion de l’industrie, qui était observable jusqu’en 2017-2018, ne se poursuit pas. Depuis 2017, il y a un certain nombre de mesures gouvernementales qui paraissent aller dans le bon sens, mais également d’autres qui sont beaucoup plus discutables. Ce qui va dans le bon sens, c’est la mise en place, après la crise des Gilets jaunes, d’un programme intitulé « territoires d’industrie », pour accompagner des projets de réindustrialisation dans les territoires des petites villes et villes moyennes. De même qu’en 2020, après la crise sanitaire, après s’être aperçu de la perte de souveraineté industrielle, le gouvernement a mis en place un fonds de relocalisation. Il y a ainsi plusieurs centaines de projets de relocalisation, de renaissance de l’industrie française, qui ont en effet été soutenus.
Par contre, ce qui va dans le mauvais sens, et c’est clairement majoritaire dans les politiques publiques, c’est qu’on reste dans une tendance générale qui consiste à dire : « Venez chez nous, vous paierez moins d’impôts. » Ce qui implique une diminution de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt de production, qui finance les collectivités locales. À cela s’ajoute une décodification du droit du travail, depuis la loi El Khomri en 2016 puis les ordonnances Macron ; puis bien sûr, le recul de l’âge légal de départ à la retraite.
Toutes ces mesures de dumping fiscal, social, et environnemental ne vont pas dans le bon sens, mais peuvent quand même attirer des projets étrangers en France. Le président a annoncé une moisson d’investissements étrangers en France, avec des milliers emplois créés. Ce qui m’incite à formuler la phrase suivante : « Une France ouverte, oui. Mais une France offerte, non. » Ce qui est mis en place c’est ce que j’appelle l’attractivité basse, où il ne s’agit pas d’ouvrir la France, mais de l’offrir aux investisseurs étrangers, pouvant au passage avoir le contrôle de certaines technologies françaises, prendre pied sur le marché français, etc.

Peut-on dire que la politique industrielle de la France, axée sur des baisses de coûts, de réduction des impôts de production par exemple, n’a eu pour effet unique que de dégrader les finances publiques tout en débouchant sur une production industrielle stagnante ?
Absolument ! Cela a dégradé les finances publiques. La Cour des Comptes le souligne chaque année. C’est considérable. Il y a l’argent qu’on verse et les impôts qu’on ne prélève pas. Selon une étude du Clersé, le financement public des entreprises industrielles s’élève à environ 140 milliards d’euros chaque année. Avec quelle efficacité au final ? Si on regarde la production industrielle française, sa part dans le PIB, on a l’impression d’un effet ciseau. C’est-à-dire que plus l’État dépense de l’argent pour soutenir l’industrie, plus la part de la valeur ajoutée de l’industrie dans le PIB tend à diminuer. Je ne dis pas que corrélation vaut causalité. Mais ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas la bonne politique qui est menée. Sinon, on devrait avoir une croissance du PIB industriel. Ce sont donc des cadeaux, sans contrepartie, qui sont faits. On fait confiance aux industriels pour qu’ils investissent en France, créent ou maintiennent des emplois s’ils le veulent bien.
Ce n’est pas de la politique industrielle ! En outre, les aides publiques possèdent une caractéristique en France que l’on ne retrouve pas ailleurs, qui est qu’elles sont ciblées sur des entreprises particulières. On va aider l’entreprise X, on va soutenir l’entreprise Y. Mais l’industrie, ce sont des interrelations. Si vous voulez soutenir un système productif, il ne faut pas soutenir les entreprises isolément. Il faut soutenir des projets collectifs. Cela se fait très peu, très mal, de manière peu organisée dans la durée alors que quand vous regardez la politique industrielle allemande, et je vous assure qu’elle existe, contrairement à ce qu’on raconte, menée à la fois par l’État fédéral et les Länder, les subventions directes à telle ou telle entreprise sont rarissimes. Elles sont accordées sur des projets qui vont rassembler un certain nombre d’entreprises, avec des universités, des laboratoires de recherche publics ou privés, etc. Les Allemands appellent cela une « action concertée », alors qu’en France, on va donner de l’argent à Arcelor-Mittal, à tel groupe chinois pour qu’il développe tel ou tel produit ou technologie.
En vantant les engagements des investisseurs étrangers, tels Elon Musk ou Lakhsmi Mittal, présents lors de l’événement « Choose France » à Versailles au printemps dernier, est-ce qu’Emmanuel Macron accentue un dépeçage de l’appareil industriel français au profit d’affairistes étrangers, à l’instar de ce qui s’est passé du côté de la branche énergie d’Alstom, vendue à General Electric en 2014, quand l’actuel locataire de l’Élysée était ministre de l’Économie ?
On peut voir les choses ainsi. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a aujourd’hui, dans l’UE, une concurrence acharnée pour faire venir des entreprises étrangères. L’Allemagne agit de la sorte, n’hésitant pas à subventionner des usines Intel, Samsung ou TSMC, pour 20 milliards d’euros, pour qu’ils investissent dans des semi-conducteurs. La différence entre la France et des pays comme l’Allemagne ou l’Italie, c’est que la capacité endogène des industries n’est plus du tout la même. En clair, depuis une trentaine d’années, le tissu industriel français s’est complètement étiolé. Nos groupes industriels ont soit été rachetés par des groupes étrangers, soit ont poursuivi une stratégie de globalisation, au point qu’on peut se demander s’ils sont encore français.

Ce qui fait qu’aujourd’hui, nous sommes globalement tributaires de nos importations. On met l’accent sur l’insuffisance de nos exportations mais il y a un énorme angle mort qui est l’ultra-dépendance aux importations, pourtant parfaitement visible durant la crise sanitaire. On a manqué de masques, de gel hydroalcoolique, de respirateurs pour les hôpitaux, d’antibiotiques ou encore de vaccins. La France est devenue un désert industriel et notre dépendance aux importations est générale. Tant dans la production de biens d’équipement, de la construction mécanique, de la machine-outil, que dans les biens de consommation des ménages.
On souligne le côté exportateur outre-Rhin, mais la production allemande sert aussi les besoins de la population. Quand la crise sanitaire est survenue, l’appareil industriel allemand a été capable de produire tous les biens nécessaires pour répondre à cette crise. Il y a une sorte d’équilibre entre un développement exogène et un développement endogène en Allemagne comme en Italie. Alors qu’en France, on n’a plus tellement d’autre solution que de faire appel aux investisseurs étrangers pour sauver ce qui peut l’être.
Pendant ce temps, on continue de démanteler la filière française du ferroviaire, par exemple. Le dernier constructeur français de roues pour les trains est dans une situation critique car son actionnaire, qui est chinois d’ailleurs, a décidé qu’il renonçait. Le gouvernement appelle de ses vœux un programme ferroviaire de 100 milliards d’euros. Mais si cela aboutit à accroître les importations, ce n’est pas compréhensible. On comprend d’autant moins bien qu’Alstom obtient des commandes de l’étranger, notamment des États-Unis. Le métro de New-York va être rénové par des rames et des signalements construits par Alstom, mais cela fera 0 exportation à partir de la France ! Et cela en raison du Buy American act, qui fait que les produits qu’ils achètent sont nécessairement fabriqués aux États-Unis.
La réponse consistant à offrir la France pour compenser le désengagement des groupes français et l’anémie depuis 30 ans du tissu industriel français est mauvaise.

En parlant de « pause réglementaire européenne » sur les normes environnementales devant des industriels en mai dernier, est-ce que Macron illustre une fois encore l’idée que le capitalisme « vert » est un oxymore?
J’ai du mal avec cette logique qui consiste à prendre le capitalisme comme il existe et à passer juste un coup de peinture verte dessus en disant: « On va mettre quelques objectifs écologiques de réduction de CO2 par exemple et ça devrait aller. » Ce qui serait beaucoup plus audacieux, ce serait de changer complètement de modèle de développement. Ça veut dire repenser l’industrie pour que celle-ci réponde aux besoins de la population. Tout à l’heure, je rappelais la dépendance aux importations de la France. Ce qui fait qu’elle ressemble plus à la Grèce, qui importe presque tout ce qu’elle consomme, qu’à l’Allemagne ou l’Italie. La France est une Grèce qui s’ignore! Il est fondamental que l’industrie française réponde aux besoins des Français, tout en protégeant la nature. C’est-à-dire en développant une industrie qui propose des biens durables, sortant du schéma de l’économie linéaire. Autrement dit, ne plus répéter ce schéma qui va de l’extraction à la production, de la production à la consommation, et une fois qu’on consomme, on jette.
Les industriels doivent penser des biens qui s’inscrivent dans la durée et ne pas incorporer des éléments d’obsolescence programmée. In fine, faire en sorte que les biens soient réparables. Il faut développer une industrie écologique, qui fait de l’éco-conception, qui calcule ses coûts de manière à ce que les coûts d’utilisation soient les plus faibles possibles, que le coût de la réparation soit inférieur à celui du changement de matériel, etc. Il faut développer une industrie qui corresponde aux objectifs du développement durable, et non pas une industrie qui pollue ou incite au recyclage alors que le recyclage est un pis-aller.

Pour que tout cela soit possible, il faut développer la démocratie salariale. Si on laisse tout le pouvoir aux actionnaires, comme c’est le cas, excepté dans l’économie sociale et solidaire, tout ce que je viens de dire ne se fera jamais parce que les actionnaires ne sont pas dans cette logique-là. Il faut que la démocratie fonctionne dans les entreprises. Il y a beaucoup de travail à faire parce que sur le plan juridique ou institutionnel, la catégorie entreprise n’existe pas. C’est seulement la catégorie société qui existe dans le droit français, à travers les chapitres du Code civil concernant la propriété privée.
Ce qui fait que les discours sur les parties prenantes sont basés sur un vide juridique absolu, parce qu’il n’y a qu’une partie prenante dans le droit français, ce sont les actionnaires. Les salariés sont considérés comme des fournisseurs de travail.
Enfin, le modèle de développement que j’évoque ne se fera jamais non plus si on continue de laisser la finance totalement libre de fixer les règles, les normes sociales et économiques. Il faut mettre la finance au service du développement. Pour cela, il n’y a pas 50 manières. Il faut taper là où est son essence. C’est-à-dire sur sa volatilité. Il faut passer d’une finance gazeuse, volatile, à une finance liquide, ayant une certaine viscosité. En clair, il faut introduire ce que j’appelle des retardateurs temporels. Il faut interdire le trading haute fréquence, permettant des opérations financières spéculatives à la nanoseconde. Et si on veut taxer, qu’on se base sur la proposition de Tobin [James Tobin (1918-2002), « prix Nobel » d’économie en 1981, NLDR], à savoir un impôt sur les transactions financières. Autre exemple, on pourrait dire au moment d’une assemblée générale des actionnaires que ceux qui détiennent leurs titres depuis moins d’un an n’ont pas de droit de vote. Et à l’inverse, valoriser ceux qui détiennent des titres depuis deux, trois ou quatre ans, minimum. Histoire de récompenser les investisseurs patients et de pénaliser les investissements spéculatifs.
Propos recueillis par Jonathan Baudoin
Gabriel Colletis est économiste, professeur à l’université Toulouse-Capitole. Il est l’auteur de Quelles crises, Quelles solutions (Éditions Uppr, 2014), L’urgence industrielle ! (Éditions Le Bord de l’eau, 2012), Les nouveaux horizons du capitalisme (Éditions Economica, 2008)

Mr Colletis est le prototype du socialiste bon teint d’antan (une sorte d’économiste aéré, aérant, d’écolo l’eau l’eau : il faudrait surtout s’occuper de l’atmosphère et ensuite de l’eau, et éventuellement de l’huile). Mais « aérer » n’est pas la solution. Non plus que « liquéfier » ou « viscosifier ».
Ce qu’il faudrait, c’est tout mettre cul par dessus tête pour changer vraiment : changer le mobilier et péter les cloisons. Les révoltes ou les grognements de bibliothèques ne servent pas à grand-chose.
Mr Gabriel Colletis colle à peu près à la norme ISO 26000 (https://www.iso.org/fr/iso-26000-social-responsibility.html ) , avant tout orientée sur une écologie non politique cad une écologie capitalo-compatible. On y parle de « parties prenantes » plutôt que « d’acteurs ou classes sociales ». Le dialogue est la clé, pas la lutte. Et quand bien même ! ceux qui décideraient à la fin, ce ne seraient pas les indiens, mais encore et toujours les cow-boys, cad ceux qui possèdent le plus de « forces productives » : monnaies, machines, canons (tiens, en passant, sur la pourriture absolue anglo-saxonne : https://www.youtube.com/watch?v=B03rmq71vYs ).
« Empêcher la volatilité de l’actionnariat, pour mettre la finance au service du développement » !!!!!! Ce serait donc une histoire de microsecondes !!!! Il se fout de notre gueule, là ! ce serait une histoire de volatilité, mais pas une histoire de propriété privée. En quoi « fixer » l’actionnariat « privé » va t’il changer le principe du profit « privé » ? L’intérêt collectif (trop souvent défini par « le plus fort ») ne pourra se faire par la somme concurrentielle des intérêts privés des plus puissants. Non, non, non !
Qui veut faire l’ange fait la bête ! Il faut chercher autre chose Gabriel.
NB : ce qui est succulent dans la norme ISO 26000 c’est qu’elle affiche clairement la couleur, d’entrée : elle prétend définir la « responsabilité SOCIETALE » et non pas « SOCIALE » de l’entreprise. C’est une nuance chère à mon coeur, et là, je dis chapeau les technocrates (les technocrates sont parfois des naïfs sincères; j’en connais de très sympathiques).