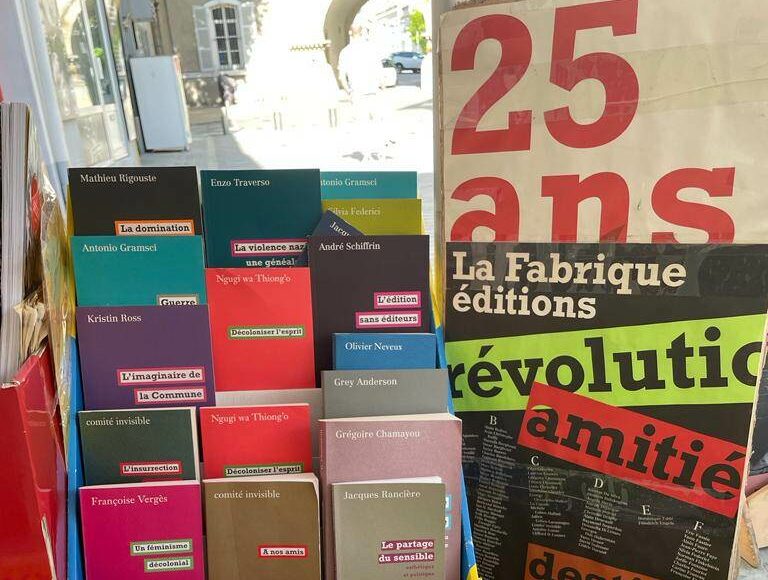Stella Magliani-Belkacem et Jean Morisot sont les nouveaux gérants de La Fabrique. Maison d’édition indépendante fondée il y a près de 26 ans, elle incarne la vision et l’engagement de son fondateur Eric Hazan, ancien chirurgien et grand défenseur de la cause palestinienne, disparu le 6 juin 2024. Un des plus importants éditeurs français pour la pensée de gauche de ces vingt dernières années. La Fabrique a publié plus de 250 titres sur des sujets toujours très politiques, sociaux et parfois avant-gardistes. Tous les grands noms de la pensée radicale contemporaine figurent à son catalogue, d’Alain Badiou à Jacques Rancière ou Edward Saïd, le Comité Invisible, Julien Coupat, Kristin Ross ou encore Slavoj Zizek. De la Palestine aux violences policières en passant par les violences sexistes et sexuelles ou la décolonisation, Eric Hazan a légué un héritage immense et précieux. Pour QG, les deux nouveaux responsables rendent hommage ici à leur mentor et à son travail, évoquent leur vision de l’édition indépendante et son articulation avec les luttes sociales. Notre journaliste Thibaut Combe les a rencontrés.
QG : Comment faire vivre l’héritage d’Eric Hazan, son engagement et son travail précieux pour l’édition indépendante?
Stella Magliani-Belkacem : L’héritage d’Eric Hazan est très concret et a été assuré de sa propre initiative. Il avait horreur de la pratique, trop courante dans nos milieux, qui s’en tient à un « après moi, le déluge. » Pendant une quinzaine d’années de collaboration, il nous a peu à peu légué la propriété économique de la maison, sa direction éditoriale mais surtout une manière de faire. Il nous a appris le métier assis à côté de nous, sur un petit tabouret, en nous accompagnant à la tâche. ll s’est montré extrêmement généreux et habile.
Jean Morisot : Son héritage, c’est aussi cette maison d’édition et son catalogue, les livres qu’il a publiés, dont chacun à gauche pourra juger de ce qu’ils ont apporté à son propre cheminement ou à la discussion politique en général. Il a donné à la maison ses grandes lignes, ses thèmes. En regardant les premiers titres, il y a des livres dès 1998 sur la Palestine avec Edward Saïd, sur la prison avec Alain Brossat, en philosophie avec les premiers titres de Jacques Rancière. Quand Eric est mort, des gens nous ont écrit pour nous dire que tel ou tel livre avait changé leur vie en changeant leur façon de voir. C’est vertigineux comme héritage, mais il l’a incarné. Pas tout seul, parce qu’il était entouré, et parce qu’il a rassemblé autour de lui des auteurs et des autrices, mais il l’a incarné.

QG : Eric Hazan disait « je ne fais pas de livre pour renflouer les caisses mais parce que je l’aime ». Dans un marché difficile pour l’édition indépendante, est-il possible de continuer à suivre une telle philosophie en jonglant entre engagement éditorial et réalité économique ?
S. M-B : Eric a aussi tout fait pour que La Fabrique soit une maison en bonne santé financière. Le nom même de la maison dit quelque chose du modèle économique qu’il a défendu : La Fabrique, ce n’est ni l’atelier ni l’usine. La maison a toujours porté un petit nombre de titres par an (une douzaine) sans que le travail ne soit trop divisé (longtemps j’ai été la seule salariée ; aujourd’hui, nous venons d’accueillir une troisième personne). Eric a vécu le grand virage des années 1990 et l’ère de la rapide concentration éditoriale : la maison paternelle qu’il avait reprise en 1983, les éditions Hazan, a été rachetée par le géant Hachette. Il en fait un récit clair dans une tribune parue alors dans la revue Esprit. Cette expérience a été douloureuse : il en a tiré de saines leçons qui nous sont encore utiles aujourd’hui. Il n’a pas fait des livres pour renflouer les caisses mais il a aussi fait en sorte de ne pas les trouer. Il a été très vigilant : il ne s’est pas tourné vers les banques pour obtenir des prêts ou n’a pas eu le désir de grandir toujours davantage. La maison existe depuis 25 ans et publie probablement moins de livres que des maisons plus jeunes encore.
J. M : Dans une maison indépendante, on se donne les moyens d’être indépendant sur nos choix, de pouvoir faire les livres qu’on aime dans les contraintes qu’on se fixe et qu’on s’impose. Et parmi ces contraintes, il y a la réalité économique, surtout quand on commence à avoir des salariés, qu’il faut payer, les imprimeurs, les gens qui travaillent avec nous. Bien sûr qu’on se demande si on va vendre suffisamment tel livre pour pouvoir rentrer dans nos frais. Mais l’important reste de décider en fonction de nos propres contraintes, qui ne sont d’ailleurs pas que financières.
QG : La Fabrique est depuis 25 ans une des maisons d’éditions phares à gauche et a publié des auteurs très importants aux idées neuves, percutantes. L’objectif est-il toujours d’ouvrir de nouveaux débats sociétaux ?
S. M-B : Une partie de nos livres s’inscrivent notamment sur des fractures qui divisent même au sein du camp de l’émancipation. C’était le cas avec Les filles voilées parlent (2008) qui tirait le bilan de la loi dite « sur le voile à l’école » portée par de larges pans de la gauche et du féminisme comme du dernier en date, Contre l’antisémitisme et ses instrumentalisations, qui réunit des figures académiques (Judith Butler, Françoise Vergès) comme militantes avec Houria Bouteldja (militante décoloniale) et Maxime Benatouil (UJFP et Tsedek). Nous ne nous effrayons pas de saisir des sujets qui ne font pas consensus dans notre camp.
J. M : Certains livres interviennent sur des plans qui ne sont pas directement liés aux préoccupations militantes. Quand on fait des livres sur le théâtre, sur la littérature, on le fait sur des plans différents, avec une arrière-pensée et un fond politique. La matière de ces livres est différente, mais il y a toujours l’envie qu’ils soient le catalyseur d’idées en mouvement. C’est ce qui oriente nos choix.
QG : L’édition indépendante à gauche est très marquée par son ancrage dans la lutte sociale, les milieux militants et plus précisément dans les mouvements populaires. Comment l’expliquer ?
S. M-B : On a parfois l’impression qu’il y a Maspero à la fin des années 1970 puis « plus rien » avant la fin des années 1990 qui voient émerger La Fabrique mais aussi Raison d’Agir, Agone et quelques autres. Le renouveau de l’édition indépendante, après cette longue période glaciaire, survient à la suite des grandes grèves de décembre 1995. Raisons d’agir est d’abord une association regroupant militants et chercheurs, fondée par Pierre Bourdieu et dirigé depuis son bureau d’universitaire au Collège de France qui se définit comme « l’état de la recherche sur des problèmes politiques et sociaux d’actualité ». Si Agone comme Raisons d’agir offrent alors une place importante à l’université et à la sociologie en particulier, La Fabrique s’inscrit, au départ, davantage dans l’anti-impérialisme et la philosophie : en 1998, ses premiers livres sont Israël-Palestine : l’égalité ou rien d’Edward Said et Aux bords du politique de Jacques Rancière. On peut parler d’une coloration différente pour chacune de ces maisons mais elles naissent dans un même moment politique. On pourrait en dire autant de la séquence 2003-2005 : l’antiracisme, le féminisme et la gauche sont agités par les débats sur le voile à l’école, Ni putes ni soumises, etc. ; en janvier 2005, les Indigènes de la République lancent leur appel ; en février 2005, la gérance Sarkozy promet une loi sur les bienfaits de la colonisation ; en novembre 2005, les révoltes des quartiers populaires éclatent. Alors, 2005 voit naître des maisons telles que Les Prairies ordinaires ou Amsterdam qui, au départ, se dédient à traduire les oeuvres marquantes des postcolonial studies, de la queer theory ou des cultural studies. On pourrait imaginer un séquençage similaire autour des mobilisations contre la Loi-Travail qui a peut-être donné lieu, à sa manière, à Divergences et à bon nombre de maisons aujourd’hui diffusées par Hobo.
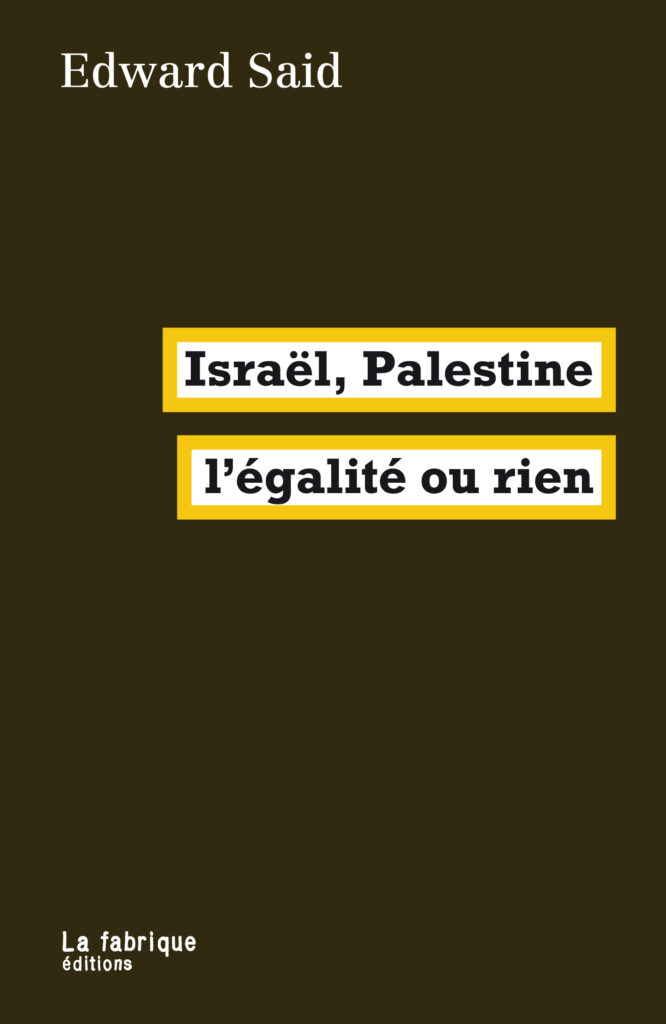
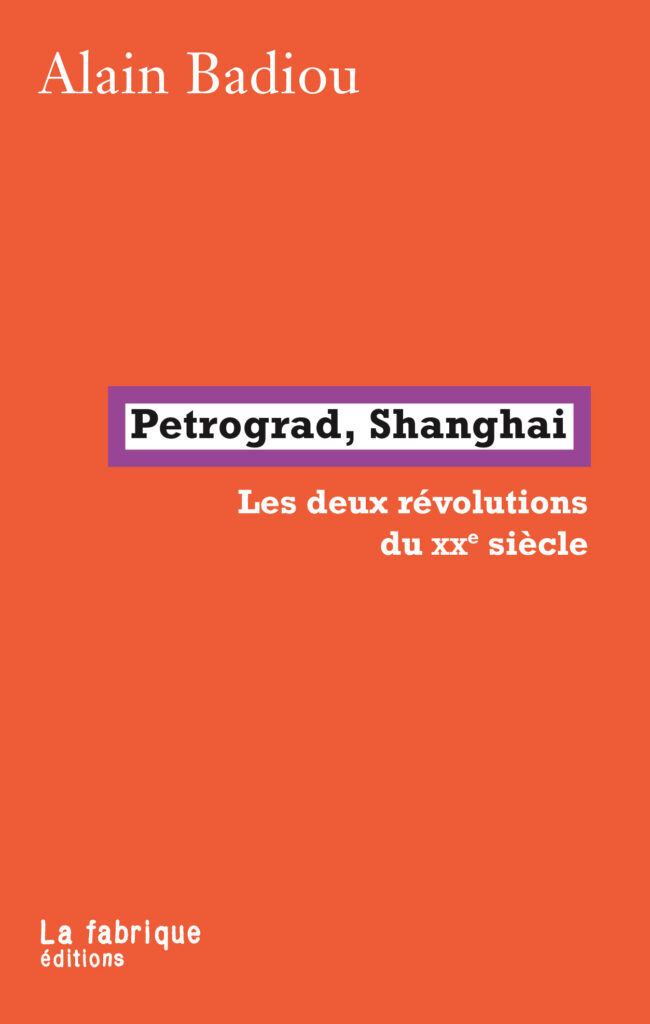
QG : Avec des moyens limités, vous arrivez à créer du débat dans les milieux militants et même en dehors. Comment voyez-vous l’influence de vos œuvres? Avez-vous par ailleurs le sentiment d’arriver élargir votre cercle de lecteurs ?
S. M-B : C’est tout de même une science très inexacte. Les chiffres de vente des livres à La Fabrique et le fond ont tendance à nettement augmenter. Peut-être qu’il y a plus de personnes qui sont de moins en moins convaincues par le consensus libéral ou peut-être qu’on convainc de plus en plus largement. C’est difficile de le savoir. Par exemple, on a republié un livre qui était sorti chez Fayard et retiré du commerce en novembre 2023, Le nettoyage ethnique de la Palestine par Ilan Pappé, un auteur historique de La Fabrique. On l’a fait pour la cause et avec le toupet qui peut nous caractériser. Plus de 18.000 exemplaires ont été vendus depuis sa publication en mai dernier.
J. M : Effectivement, quand on vend 3.000 exemplaires d’un livre, ou même 10.000, en regard des millions de gens qui sont possiblement lecteurs, on doit rester modestes sur l’influence de nos livres. Cela dit, on ne fait pas de livres dans notre coin. Si nos moyens sont incomparablement plus faibles que ceux des grands groupes d’édition, on bénéficie d’une très bonne diffusion, grâce au travail du distributeur-diffuseur BLDD (Belles Lettres Diffusion Distribution), grâce au soutien de la librairie indépendante et de médias indépendants. Pour certains sujets, il y a aussi le travail de médiation que font les organisations politiques quand ils se saisissent d’un titre pour alimenter leurs discussions et leur réflexion. Ce sont des choses qui font que l’influence d’un livre peut être plus grande que ce que permet au départ les moyens à notre portée.
QG : Est-ce qu’un tissu, une « entraide » se créé dans l’édition indépendante ? Êtes vous liés aux autres maisons, notamment via le réseau de diffusion-distribution ?
S. M-B : On a toujours de la sympathie pour les maisons indépendantes de sciences humaines. Il ne faut pas imaginer que ces maisons se cannibalisent et que l’une prend la place d’une autre en librairie. Ce n’est pas du tout comme cela que ça fonctionne. Une table de librairie fonctionne avec des thématiques, par écho. Plus nous sommes nombreux, mieux nous existons en librairie. On accueille toujours les jeunes éditrices et éditeurs qui nous sollicitent avec autant de bienveillance que possible et en se montrant généreux. L’entraide existe aussi au-delà des frontières ; c’est même vital d’avoir des amitiés sincères avec des maisons de langue anglaise, espagnole, etc.
J. M : On a de la chance de faire un commerce où il n’y a pas de concurrence à part la place en librairie. On se retrouve de fait dans des salons où on se croise, on discute. On est à peu près tous reliés à des structures de diffusion-distribution puisqu’il n’y en a pas beaucoup pour des éditeurs comme nous : il y en a trois. Les Belles Lettres (BLDD), qui diffusent nos livres, ceux de Amsterdam ou encore ceux de l’Arche. Harmonia Mundi diffuse Libertalia ou Lux Éditeur et Hobo Diffusion s’occupe de Divergence et d’un tas de petites maisons. Nous sommes réunies par les mêmes canaux de distribution-diffusion.
S. M.B : Le jour où il n’y aura plus de diffuseurs-distributeurs indépendants, comme en Italie, toute la chaîne s’effondrera. Et les trois n’ont pas tous les mêmes outils, la même force de frappe. Il y en a des plus petits ou des plus fragiles que d’autres. Quand on parle d’indépendance du Livre, c’est vers ce chaînon qu’on devrait aussi orienter notre inquiétude, et pas seulement vers la librairie ou l’édition.
QG : Nicolas Norrito de Libertalia pense qu’une de ses missions d’éditeur est l’éducation populaire de la jeunesse avec ses livres. Vous pensez que vous avez un rôle “d’éducation” des jeunes lycéens qui découvrent les luttes, les enjeux sociaux ?
S. M-B : La jeunesse n’a pas besoin de nous pour se former et se remuer. Mais souvent, quand tu commences à militer, tu as un appétit de savoir pour pouvoir moucher le bec à table des vieux croûtons qui t’embêtent pendant les repas de famille ou pour trouver une place dans tes nouveaux cercles militants. C’est un moment où on se tourne vers les livres. Il y a des livres qui sont davantage saisis ou ressaisis par la jeunesse comme Comment saboter un pipeline d’Andreas Malm qui arrivait au moment des marches pour le climat. Le livre de Mathieu Rigouste, La Domination Policière, en 2012 est un bon exemple aussi. À cette époque, à gauche, et plus à gauche encore, personne ne se préoccupe de la violence policière et de son caractère systémique. La Fabrique à commandé ce livre à Matthieu Rigouste et nous étions alors contents de le faire pour la cause. Aujourd’hui, en étudiant la courbe des ventes de ce livre-là, à chaque mouvement social, celle-ci remonte : Loi travail, Gilets Jaunes, retraites.

QG : Avez-vous le sentiment que le livre reste une arme comme le disait Eric Hazan ?
S. M-B : L’éditeur en langue anglaise d’Andreas Malm, Sebastian Budgen (Verso Books), me disait qu’il avait le sentiment qu’en France, le livre avait encore l’impact sur le débat d’idées qu’il n’a plus, selon lui, dans le monde anglophone. Si le livre d’Andreas Malm par exemple, n’a pas été directement attaqué, il a été saisi chez des militants et militantes arrêtés, a figuré dans le premier paragraphe du décret de dissolution des Soulèvements de la Terre promulgué par Darmanin. Ce livre a été traduit en 8 langues : aucun de ces autres éditeurs n’a eu à subir de telles attaques. Ce n’est pas la première fois qu’un livre du catalogue qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire est mobilisé à des fins de répression. Ce fut le cas lors de l’affaire Tarnac qui s’est soldée par un camouflet pour le pouvoir. Ces nouvelles formes d’intimidation qui pèsent sur les maisons d’édition peuvent laisser penser que les livres, les auteurs, les idées et les libraires qui les défendent sont à craindre.
J. M : On n’a pas encore trouver mieux que les livres pour défendre des idées. Toute l’histoire intellectuelle et politique est scandée par des publications. Au sein de la gauche, du mouvement ouvrier, les idées se forment dans les luttes, dans la confrontation au réel, mais les livres peuvent aider à marquer des étapes, à donner une orientation, voire à constituer des points de ralliement.
QG : Ernest Moret (représentant des ventes de la maison à l’étranger) a été arrêté en avril 2023 par l’antiterrorisme britannique pour son travail à La Fabrique et ses possibles participations aux mouvement contre la réforme des retraites. Comment avez-vous soutenu votre collaborateur et qu’avez vous tiré de cet inquiétant événement?
S. M-B : Le grand bruit médiatique, nous en avons été les principaux acteurs et de manière extrêmement volontariste. Si ça a fait du bruit en France, ça a fait du tonnerre en Grande-Bretagne. Nous étions en déplacement vers la foire du Livre de Londres (événement international qui réunit des centaines d’éditeurs internationaux) quand Ernest a été arrêté. Eric Hazan nous a appris à ne surtout pas faire profil bas : appuyé par nos confrères britanniques, on a mis en branle une tribune d’éditeurs étrangers, une tribune d’éditeurs français, une tribune de libraires, une tribune des auteurs de la maison. J’ai répondu nuit et jour à des journalistes, j’en ai sollicités, je suis allée au Congrès National des Journalistes du Royaume-Uni pour qu’on fasse une motion spéciale. Les services anglais ne savaient pas trop ce qui se passait, ils ne comprenaient pas très bien la situation et ne réalisaient pas qu’ils avaient mis sous clé quelqu’un qui travaillait pour une maison d’édition. Ce bruit a été fait à bon escient puisqu’Ernest a depuis reçu les excuses publiques de la Metropolitan Police et un dédommagement financier pour ces quelques huit heures de garde à vue antiterroriste. Si en France, l’antiterrorisme ne peut pas avoir accès à l’ordinateur d’un éditeur sans aucun motif valable, il faut croire qu’on peut faire passer le message en gare de Londres à l’antiterrorisme britannique pour qu’il s’en charge. Je pense que les Britanniques se disent aujourd’hui que les Français leur ont refilé une peau de banane.
QG : Un climat hostile entoure les militants ou même les éditeurs qui luttent contre l’ordre établi, qui explorent des sujets sensibles. De quel œil voyez-vous ces attaques et la criminalisation de ces milieux de la part du pouvoir et de ses alliés ?
S. M-B : Si on s’arrête sur cette affaire et sur d’autres, on peut parler aujourd’hui d’un nouveau maccarthysme, d’une pression particulière qui pèse sur les auteurs, sur les maisons, mais aussi sur les libraires. De nombreuses librairies ont été victimes ces dernières années d’attaques assez inouïes. Les Parleuses (proche de Nice) qui s’est faite recouvrir la vitrine, parce qu’elle avait une vitrine féministe qui invectivait le ministre de passage. Il y a eu la librairie Terra Nova à Toulouse, parce qu’elle recevait Houria Bouteldja et Louisa Yousfi qui a eu droit à un collage absolument abject, qui comparaît le fait de recevoir ces deux autrices aux actions de Mohammed Merah (tueur islamiste de 7 personnes, dont plusieurs enfants, à Toulouse et Montauban en 2012). À Toulouse, c’est quelque chose de très traumatisant. Et puis ce maccarthysme est très vivace aujourd’hui dans le choix des subventions offertes par la puissance publique. Il faut voir ce que Valérie Pécresse à la Région Île-de-France ou Laurent Wauquiez à Lyon ont fait au livre et à la culture.
J. M : Il y a certaines opinions qui sont particulièrement pourchassées, criminalisées en ce moment. Défendre les Palestiniens aujourd’hui, c’est risquer de voir ses conférences dans les universités annulées, ou pour les artistes, de voir leur travail censuré, pour les institutions culturelles de voir leurs subventions coupées, etc. Il y aussi un certain nombre de luttes écologistes qui sont réprimées et plus généralement une radicalisation de l’État qui se manifeste dans des coups de pression, mais aussi des appareillages juridiques et des offensives policières.

QG : Les livres de sciences humaines critiques du système établi sont nombreux et arrivent à mobiliser de plus en plus, notamment lors de rencontres en librairie. Que pensez-vous de cette évolution et comment l’expliquez-vous ?
J.M. : Tant que les conditions n’auront pas complètement changées, les critiques qui leur font face continueront d’exister. Celles qui affrontent depuis deux siècles les effets du capitalisme économique, de l’impérialisme. Elles ne se déploient plus dans les grandes maisons d’édition, comme elles le faisaient encore il y a quelques décennies. Par contre, il y a un fourmillement de petites maisons qui ont pris le relai.
S. M-B : On peut dire aussi que le travail de formation et de débat qu’assuraient les grands partis du mouvement ouvrier n’existe plus aujourd’hui. Et l’université s’avère être un espace de plus en plus restreint et fermé. En revanche, quand j’ai commencé ce métier, une rencontre en sciences humaines en librairie, réunissait 12 personnes et on était contents. Aujourd’hui, j’ai le sentiment que les rencontres autour des sciences humaines mobilisent beaucoup de publics en librairie. Les libraires jouent un rôle dans la vitalité de ce débat public qui est tout à fait notable. Il y a beaucoup plus de rencontres en librairie aujourd’hui sur des sujets prégnants. Il y a presque une rencontre par jour quelque part en France avec un auteur à La Fabrique. Il nous arrive que les foules se pressent au point où on ne peut pas accueillir les gens dans la librairie. Les libraires jouent un rôle particulièrement important dans la bataille.
Interview par Thibaut Combe
Photo : La fabrique/Hannah Assouline, 2022
Stella Magliani-Belkacem travaille à La Fabrique et a longtemps été seule salariée. Elle est aujourd’hui co-gérante de la maison d’édition. Elle a également participé à la rédaction d’ouvrages tels que Les féministes blanches et l’empire (2012) et Contre l’arbitraire du pouvoir (2012).
Jean Morisot est co-gérant de La Fabrique. Il travaille depuis une quinzaine d’années pour la maison d’édition.