La diplomatie du tweet, chère à Donald Trump, va-t-elle permettre la fin de la guerre russo-ukrainienne? Les rencontres de ces derniers jours, 0utre-Atlantique, entre le président américain et le maître du Kremlin d’une part, puis entre Trump et Volodymyr Zelensky, plus les dirigeants européens, n’ont pas encore démontré leur efficacité. Pour David Teurtrie, chercheur associé à l’INALCO, spécialiste de la Russie, la séquence diplomatique observée montre une marginalisation de l’Europe dans la résolution du conflit, désormais court-circuitée par la Russie et les États-Unis. Et au sein de cette Europe, une voix française qui a définitivement cessé d’être singulière sous l’ère Macron. Interview par Jonathan Baudoin

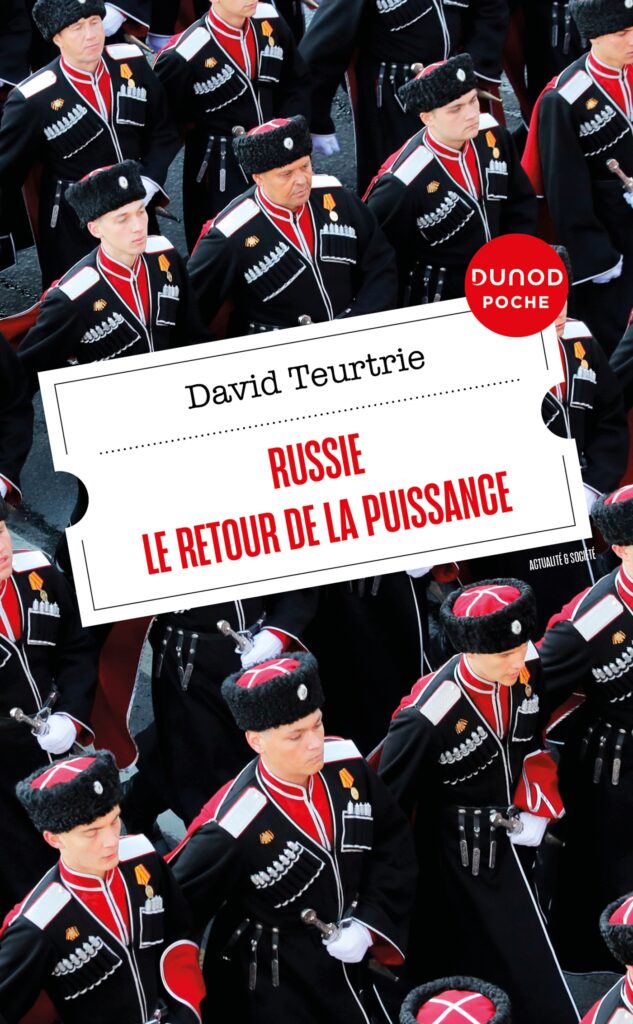
Quel regard portez-vous sur les récentes rencontres Outre-Atlantique au sujet de la résolution de la guerre russo-ukrainienne?
Au premier abord, ces rencontres donnent l’impression d’une nouvelle étape importante dans les tentatives de règlement diplomatique du conflit. Il s’agit avant tout du sommet américano-russe en Alaska, première rencontre entre les chefs d’État russe et américain depuis le début de la guerre, où certains éléments nouveaux en vue du règlement du conflit ont émergé.
Toutefois, la deuxième rencontre, à Washington, laisse un sentiment beaucoup plus ambivalent parce qu’on a vu ré-émerger des propositions anciennes qui sont largement irréalistes, notamment le déploiement de troupes européennes en Ukraine, et qui risquent de contribuer à un enlisement des efforts diplomatiques.
Estimez-vous que Donald Trump est plus enclin à écouter les demandes émanant de Vladimir Poutine, comme le dénoncent plusieurs analystes dans les médias?
Depuis qu’il est revenu au pouvoir, Trump a fait évoluer la position générale de l’Occident pour la rapprocher de la position russe. Il y a effectivement une certaine compréhension, de la part du président américain, des arguments avancés par les Russes ce qui peut donner parfois l’impression d’une forme d’alignement. Maintenant, il ne faut pas surestimer d’éventuelles affinités personnelles du président américain à l’égard de Poutine. D’une part, Donald Trump prend en compte les rapports de force, notamment sur le terrain. La Russie tient les territoires qu’elle a conquis, et est même en progression depuis au moins un an. C’est en partie la prise en compte de cette évolution militaire qui amène Washington à prendre des positions qui paraissent favorables à Moscou. Donald Trump fait preuve de réalisme vis-à-vis de la situation ce qui se reflète dans ses propositions de règlement.
La deuxième chose, c’est que Trump a, semble-t-il, tendance à être influencé par ses interlocuteurs. Par exemple, alors qu’à l’issue du sommet avec Poutine, on pouvait avoir l’impression d’une forme d’alignement sur les positions russes (absence de cessez-le-feu, échanges de territoires). À l’issue de la rencontre de Washington, Donald Trump a, semble-t-il, repris l’idée d’un déploiement de troupes européennes en Ukraine. Ce qui est une ligne rouge pour Moscou.
On peut y voir une forme de versatilité du leader MAGA. Il me semble qu’en réalité Donald Trump manœuvre en fonction de ses interlocuteurs parce que son objectif principal, c’est de se désengager du conflit.

Quel regard portez-vous sur la proposition d’une rencontre entre Zelensky et Poutine en Suisse, et par celle faite par Poutine lui-même de rencontrer le leader ukrainien à Moscou?
Sur une éventuelle rencontre Poutine-Zelensky, je crois qu’il faut être extrêmement prudent. D’une part, il y a à ce sujet un retournement de situation rarement rappelé dans les médias: il y a encore deux ans, une telle rencontre était combattue en Ukraine et en Occident. Le mot d’ordre était d’isoler au maximum Vladimir Poutine. Désormais, les Européens se disent favorables à une rencontre entre Zelensky et Poutine. Ce changement est en grande partie lié à une situation en Ukraine qui est très défavorable aux Ukrainiens et aux Occidentaux qui les soutiennent. Cependant, il semblerait que les responsables occidentaux prennent leurs désirs pour des réalités. En effet, Vladimir Poutine ne souhaite pas rencontrer Volodymyr Zelensky, sauf si c’est pour parapher à un accord imposé par la Russie. N’oublions pas que le Kremlin remet en cause régulièrement la légitimité de Zelensky dans la mesure où l’élection présidentielle ukrainienne qui devait avoir lieu en 2024 a été annulée. Je pense que dans la vision du Kremlin, une victoire russe en Ukraine comprendrait également le départ de Zelensky.
Pourtant, officiellement Vladimir Poutine n’a pas exclu l’idée d’une rencontre avec son homologue ukrainien. Il s’agit à la fois pour le maître du Kremlin de garder toutes les options ouvertes et d’appliquer une stratégie d’évitement vis-à-vis des demandes américaines afin de ne pas susciter chez Trump un raidissement inutile. Mais les dernières déclarations de Lavrov et des diplomates russes, qui disent « on est encore très loin du compte pour envisager une rencontre entre les deux hommes », soulignent, selon moi, que cette rencontre n’est pas près d’arriver.
Enfin, il y a la question du pays d’accueil d’une telle rencontre. Les lieux proposés en Europe ne seront pas acceptés par les Russes. La diplomatie russe affirme que la Suisse, qui applique toutes les sanctions décidées par l’Union européenne, ne fait plus figure de pays neutre propice pour organiser des rencontres de ce type. Le fait que les négociations aient lieu en dehors de l’Europe (Istanbul, Alaska, Washington) est une illustration parmi d’autres du déclassement européen.
Peut-on dire, suite à ces différents sommets, que Moscou a l’initiative diplomatique, en plus de la dynamique militaire? Si tel est le cas, dans quelle mesure cela pourrait influencer un accord ou une absence d’accord avec l’Ukraine?
Moscou a des atouts importants mais n’a pas réellement l’initiative diplomatique. Le Kremlin se contente plutôt de manœuvrer face aux initiatives américaines. C’est un peu à l’image de la situation militaire. La Russie est plutôt en position de force sur le terrain militaire mais elle n’a pas obtenu de résultat éclatant qui, pour le moment, puisse permettre à la Russie de dicter ses positions. Certes, Vladimir Poutine a obtenu des États-Unis d’importantes concessions. D’une manière ou d’une autre, il n’y aura pas d’Ukraine dans l’OTAN [Organisation du traité de l’Atlantique nord, NDLR]. C’est déjà acté. Reste encore à le fixer sur le papier. Y aura-t-il un accord ferme entre l’OTAN et la Russie? Est-ce que cela va être définitif ou bien un report à long terme? Il reste une ambiguïté sur la façon dont ce sera formulé. Par ailleurs, la Russie va garder les territoires conquis dans les régions qu’elle revendique. Ce sont les deux grandes concessions faites par Washington auprès de Moscou. Mais je dirais que ces concessions sont sans surprise car elles découlent de la situation militaire à partir du moment où la contre-offensive ukrainienne a échoué. Sous l’administration Biden, il y avait déjà des débats similaires aux États-Unis à la fois sur les territoires et sur l’OTAN. On se rappelle qu’au sommet de l’OTAN de l’été 2024, l’administration Biden avait refusé de s’engager définitivement sur l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. En fait, Trump accepte ce qu’a priori une nouvelle administration démocrate aurait sans doute accepté pour sortir du conflit. C’est-à-dire la réalité des rapports de force.
Mais le plus dur reste à faire : quid du statut des territoires conquis ? Quelle sera la formule utilisée : une formule ambiguë du type « Nous reconnaissons que, de facto, ces territoires sont contrôlés par la Russie« , ou bien plus définitive: « Nous reconnaissons que c’est une partie intégrante du territoire russe« . Par ailleurs, on ne sait pas ce qu’il va advenir de l’armée ukrainienne. La Russie demande une réduction des forces armées ukrainiennes. On ne sait pas trop quelles ont été les éventuelles discussions entre Russes et Américains sur ce sujet très important. C’est un des éléments clé du conflit.
De fait, on a quelques éléments de base de règlement du conflit, qui reflètent le rapport de forces actuel. Mais pour le moment, il n’y a pas d’accord qui refléterait une forme de victoire russe.

En dépit de l’activité diplomatique affichée à Washington, est-ce que les pays européens, notamment la France, sont clairement marginalisés dans les relations internationales concernant la guerre russo-ukrainienne?
Il y a évidemment une forme de marginalisation. Pour participer au règlement d’un conflit, il faut discuter avec les deux parties. C’est le b.a-ba de la diplomatie. Or, les Européens refusant de parler aux Russes, ils sont logiquement exclus de la table des négociations. D’une manière générale, ce refus européen de la diplomatie, à savoir discuter avec les pays avec lesquels on est en désaccord, est inquiétant, bien au-delà du conflit ukrainien.
Non seulement les Européens se mettent dans la main de Washington, mais ils se placent dans la dépendance d’un Donald Trump qui a une forte condescendance pour ces mêmes Européens. Et l’image des dirigeants européens alignés devant le bureau de Donald Trump, qui se veut le maître de l’Occident, est un désastre. C’est une humiliation de l’Europe sur la scène internationale. C’est d’autant plus frappant qu’à l’arrivée de Donald Trump, les Européens avaient affirmé qu’ils allaient prendre leur destin en main. Et c’est exactement l’inverse qu’on observe.
Quelle est votre réaction par rapport aux propos de Macron, qualifiant Poutine de « prédateur, d’un ogre à nos portes », et la Russie de « puissance de déstabilisation »?
C’est de la rhétorique. Le terme d’ogre renvoie à un vocabulaire utilisé dans les contes pour enfants. On peut avoir l’impression que le président français nous raconte une histoire, le soir, pour faire un peu peur. Raconter une histoire édifiante pour les enfants, cela peut avoir une vertu pédagogique. Par contre, raconter une histoire à des adultes, qui sont ses électeurs, qui sont des citoyens, c’est beaucoup plus inquiétant de la part d’un chef d’État.
Ensuite, qu’Emmanuel Macron estime que la Russie est devenue une menace, de par son comportement en Ukraine, cela peut s’entendre. Seulement, on est un peu étonné que ces formules soient utilisées au moment où il y a des efforts diplomatiques pour tenter de trouver une sortie à cette crise. Quand on fait ce genre de déclaration, a priori, cela a plutôt tendance à raidir l’autre partie, relancer une forme de confrontation.
Cela laisse songeur sur les objectifs réels d’Emmanuel Macron. Veut-il vraiment jouer la carte de la diplomatie? Ou bien tente-t-il de relancer une politique de défiance, de confrontation ? En réalité, le président Macron est plus dans de la rhétorique que dans l’action pratique parce que, comme le reste de l’Europe, il s’est exclu du cœur des négociations, qui ne peuvent avoir lieu qu’avec les Russes.
Cela relève à la fois d’une forme de refus de la diplomatie et d’une forme de théâtralité qui est liée à un président français qui représente une France largement affaiblie et qui l’est encore plus parce qu’elle ne joue plus son rôle d’équilibre qu’elle a longtemps joué. Une puissance qui parlait à toutes les parties, qui tentait de se positionner de manière autonome. Avec Emmanuel Macron, la France s’est ralliée à Washington, au point de quémander une forme de strapontin, auprès des États-Unis, dans ces négociations. Et c’est extrêmement problématique pour la voix de la France.
Propos recueillis par Jonathan Baudoin
David Teurtrie est maître de conférences à l’Institut catholique d’Etudes supérieures (ICES), membre de l’Institut des études slaves et chercheur associé à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO). Il est l’auteur de Russie : le retour de la puissance (Dunod, réédition 2024)

