« La gauche est déconnectée du peuple » ou encore « Le wokisme marginalise la gauche ». Des idées qui sont répétées en boucle dans les mass medias pour décrire la relation entre le peuple et les partis progressistes. Mais qui ne se vérifient pas nécessairement dans les faits selon les auteurs du livre Nouveau peuple, nouvelle gauche (éditions Amsterdam). Pour QG, le sociologue Julien Talpin, coordinateur de ce livre collectif, souligne que les forces de gauche peuvent encore convaincre les classes populaires et les unifier, à condition, entre autres, d’arriver à les faire connaître, à les rendre légitimes dans leurs rangs militants et dans leurs directions respectives; à l’instar de ce que fit le Parti Communiste au 20ème siècle. Interview par Jonathan Baudoin
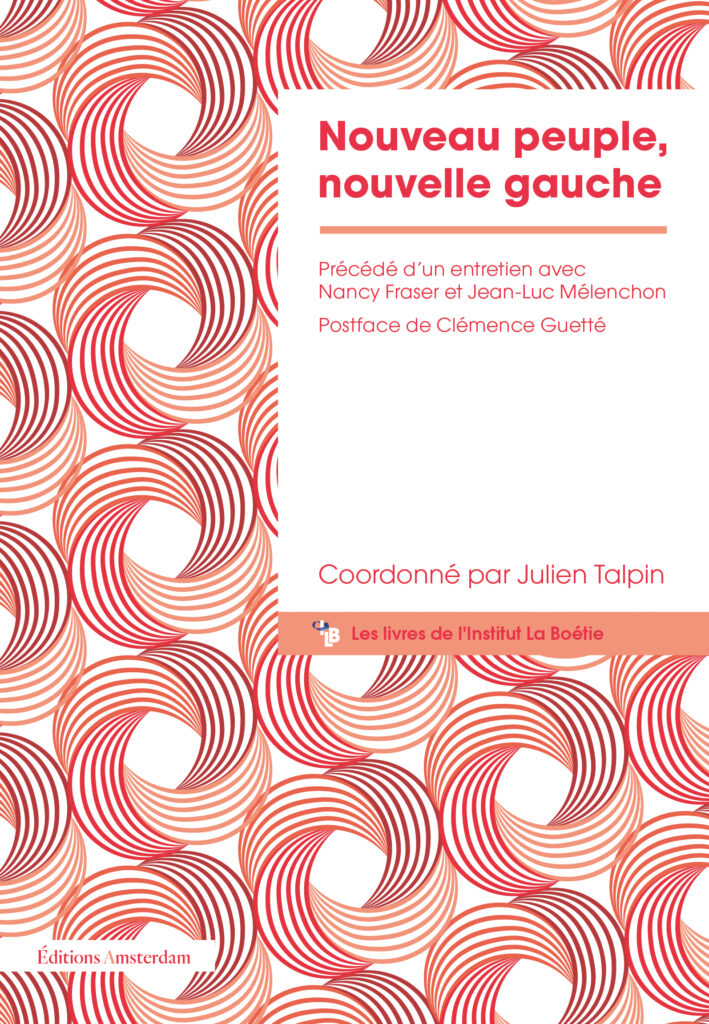
Quels sont les principaux facteurs de la transformation de la classe ouvrière en classes populaires ces dernières décennies et comment la gauche peut s’y retrouver pour formuler une offre politique cohérente face à ce nouveau peuple?
Ce passage de la classe ouvrière aux classes populaires est un acquis dans les sciences sociales, où il y a eu beaucoup de travaux ces dernières décennies sur cette question, sur la définition et le contours des classes populaires contemporaines. Un des enjeux du livre, c’est de rendre accessibles ces connaissances-là, puisque la cible du livre ce sont les militants de gauche et plus largement les citoyens.
Un des principaux facteurs c’est la transformation du capitalisme depuis une quarantaine d’années. Le déclin du capitalisme industriel a entraîné une mutation sociale, une précarisation des conditions de travail, l’individualisation des conditions d’emploi. C’est ce qu’analyse Sarah Abdelnour dans son chapitre, au début du livre, pour dire que la figure des classes populaires, restreinte aux seuls ouvriers, n’existe plus; et qu’il faut prendre en compte la diversification des conditions de travail. Mais aussi prendre en compte l’emploi non-salarié pour saisir ces transformations-là. Il y a une pluralisation des conditions de travail des groupes dominés.
Ensuite, il y a une plus grande prise en compte de facteurs qui étaient jusqu’alors invisibilisés. On avait ce regard sur la classe ouvrière avec au centre la figure de l’homme ouvrier blanc. Aujourd’hui, on prend davantage en compte des questions de genre, d’origine, d’inégalités ethno-raciales, etc. Il faut prendre cette perspective intersectionnelle et la pluralité des facteurs de domination pour saisir ce que vivent les classes populaires.
C’est au croisement des transformations structurelles du capitalisme et d’un changement de regard qu’apparaît cette cartographie des classes populaires, fragmentées, moins unifiées qu’elles ne pouvaient l’être par le passé.
En quoi la fragmentation actuelle du nouveau prolétariat diffère-t-elle de celle frappant le prolétariat du début du 19ème siècle, pour inculquer « une conscience de classe »?
C’est intéressant d’avoir une perspective historique car on a tendance à avoir une lecture mythifiée de ce qu’était la classe ouvrière et de ses conditions d’unification; comme si la classe ouvrière était née naturellement du capitalisme industriel du 19ème siècle. Ce que montre Samuel Hayat dans son chapitre, c’est que la classe ouvrière, les catégories populaires, ont toujours été fragmentées selon différents critères. D’une certaine façon, ça a été l’œuvre du mouvement ouvrier de produire cette unification-là. La question de la fragmentation des milieux populaires a toujours traversé les réflexions stratégiques à gauche. Avant même l’avènement du capitalisme industriel, il y a eu un travail politique de construction d’une unité des milieux populaires, qui avaient des statuts et des conditions très différents à l’époque aussi, entre les artisans, certains travailleurs ruraux et le proto-capitalisme industriel.
Cela montre bien comment l’unification des classes populaires, ou le dépassement de leur fragmentation, n’est pas qu’une question structurale, liée aux structures économiques. Mais aussi une question politique d’organisation collective.

En quoi l’opposition entre ruraux et urbains au sein des classes populaires est un lieu commun à « déconstruire » ? Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes peut servir d’exemple de cette déconstruction?
C’est un enjeu important, qui traverse le débat public depuis une quinzaine d’années avec les lectures autour de la « France périphérique ». Le chapitre de Clara Deville et Pierre Gilbert montre que les conditions d’existence, en réalité, des différentes strates des catégories populaires sont assez similaires. Il y a des éléments partagés dans le rapport au travail, avec la précarisation des conditions d’emploi, l’importance du travail fait à côté, des formes de travail qu’on peut qualifier de subsistance, des formes de débrouille pour s’en sortir face aux défaillances de l’État social.
Autre élément partagé, c’est le rapport à l’espace et au territoire. Il y a des formes de relégation spatiale, qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui se traduisent de manière concrète à travers le transport. Que ce soit en voiture ou en transports en commun, les classes populaires résident principalement dans des espaces périphériques qui supposent des temps de déplacements importants. Cela peut créer des aspirations communes. C’est un autre point mis en évidence par ce chapitre. Il y a des attentes partagées par les différentes strates des milieux populaires. Notamment en matière de services publics plus présents et plus fonctionnels, comme la santé, l’éducation, la poste, etc. Quand on a une lecture, qui n’est pas une lecture spatialiste, mais qui se base sur les conditions matérielles, objectives, d’existence, sur les styles de vie et les aspirations populaires aussi, on se rend compte que les différences sont moins importantes qu’on ne le dit, même si elles existent.
Malgré tout, et l’histoire des Gilets jaunes l’enseigne, c’est aussi dans la mobilisation collective, dans la lutte, que les gens se rapprochent. Il faut créer des espaces pour cela. Le mouvement des Gilets jaunes a pu contribuer à une forme de socialisation car il y a eu aussi un travail politique en ce sens. Je pense à l’initiative du Comité Vérité et justice pour Adama qui a fait le choix de chercher la jonction avec les Gilets jaunes, autour notamment de la question de la répression policière. Ce qui a permis de créer des expériences communes entre des gens qui se connaissaient relativement peu.
Au-delà, il y a eu des rencontres, inter-classistes, sur les ronds-points, où des gens qui se fréquentent assez peu, ont contribué à orienter le mouvement, à expurger ses formes les plus réactionnaires, racistes, qui pouvaient exister au départ et qui furent balayées par cette expérience commune qui se crée petit à petit, et qui va permettre, un peu, cette jonction. Je crois que le mouvement des Gilets jaunes est intéressant de ce point de vue-là, montrant qu’il est possible, par la lutte en commun, de dépasser certaines distances entre les différentes strates des milieux populaires.


Pour quelles raisons ce collectif affirme que la droitisation de la société française, mais aussi européenne, est à relativiser?
Les données, notamment dans le cas français avec le travail du sociologue Vincent Tiberj depuis plusieurs années, à l’aide d’une multiplicité d’enquêtes d’opinion, montrent bien que sur tout un ensemble de sujets, notamment sur la redistribution économique et sociale, les aspirations de justice sociale, mais aussi sur les questions dites culturelles, raciales, environnementales ou de genre, la population est moins réactionnaire qu’on ne le présente. Les aspirations à l’ordre, à la sécurité, la mise à l’agenda des questions d’immigration, sont d’abord une production politique d’en haut et moins une aspiration populaire d’en bas. Ce que montre Vincent Tiberj, c’est que la droitisation est d’abord celle des élites économiques, médiatiques et politiques. Il souligne en particulier combien ce progressisme, ce libéralisme culturel qui progresse, est souvent marqué dans la jeunesse, bien que celle-ci demeure plurielle. C’est assez marqué chez les femmes aussi.
On a d’autres enquêtes qui montrent que c’est relativement la même chose à l’échelle européenne. Ce qui a des conséquences politiques. Un chapitre du livre souligne combien les tentatives de certains partis de gauche, plutôt sociaux-démocrates, de réorienter leur ligne politique pour capter les sentiments soi-disant conservateurs des milieux populaires avaient échoué à moyen terme. Notamment en Europe du Nord. Une offre politique à la fois sociale et sécuritaire n’est pas toujours très payante électoralement et en réalité on perd un peu sur les deux tableaux. On perd des gens de gauche qui finissent par se détourner du vote et on ne parvient pas à reconquérir les gens qui ont des aspirations d’extrême-droite. Ce qui pose des questions stratégiques: quel groupe faut-il chercher à mobiliser en priorité?
Comment les partis de gauche peuvent inclure les classes populaires dans leurs rangs, voire dans leurs directions, sans verser dans une domination des élus sur les militants?
Cela demeure une question fondamentale pour la gauche. Ce que montrent tout un ensemble de travaux, c’est que la gauche est, aujourd’hui, majoritairement composée de membres des classes moyennes et supérieures chez ses militants, mais plus encore chez ses dirigeants politiques. Ils ne sont pas à l’image des catégories populaires. Il y a des petites évolutions, notamment à l’échelle locale, dans la représentation des minorités ethno-raciales par exemple aux élections municipales comme en Seine-Saint-Denis par exemple. Une initiative récente du collectif Démocratiser la politique montre bien que la gauche représente un peu mieux les classes populaires que la droite. Mais au regard de la centralité de cette question-là pour la gauche, il y a encore beaucoup de travail.
Que faire? Il n’y a pas de solution évidente. Démocratiser la politique propose des formes de parité sociale pour favoriser la représentation des classes populaires. Le problème n’est pas tant d’avoir des militants issus des milieux populaires que de les faire monter. Il y a une disjonction entre les militants de la base et les dirigeants politiques. Il faut donc se poser la question des modalités de sélection des candidats.
C’est ce qu’a fait l’Institut La Boétie dans son travail de formation militante, qui s’est structuré depuis quelques années, avec des procédures pour sur-sélectionner dans leurs cursus de formation des militants plutôt issus de milieux et de territoires populaires. Ce qui m’amène à souligner que le travail de formation à la base est également essentiel pour renforcer les capacités d’action des milieux populaires au sein des organisations de gauche. On constate qu’il y a un sentiment d’illégitimité chez les catégories populaires à prendre la parole ou à prendre la place. C’est la construction de cette légitimité, pour qu’on laisse la place à ces groupes-là, qui peut aussi se jouer par un travail de formation militante et d’éducation populaire. Y compris chez les groupes les plus éduqués, apprendre à laisser la place et la parole aux autres.
Quelles leçons fournit l’histoire de la formation des militants communistes du 20ème siècle et qu’est-ce qui mérite d’être perfectionné selon vous?
Il y a pas mal de choses à apprendre de cette histoire. Premier élément, je l’ai déjà évoqué, c’est que la formation militante est un enjeu fondamental pour la gauche dans son projet de transformation sociale et dans son projet que les classes populaires soient représentées par elles-mêmes. C’est quelque chose qui était assez délaissé depuis le déclin du mouvement ouvrier et qui est en train d’être repris, notamment par l’Institut La Boétie. Avoir des écoles de formation des militants qui s’inscrivent dans la durée, et non pas juste des universités d’été par exemple, c’est important. Mais il faut s’en donner les moyens.
Deuxième élément, la figure de l’aristocratie ouvrière, qui était issue de cette formation militante communiste au 20ème siècle, est à reprendre avec une distance critique. Le risque, c’est de ne mettre en avant que ceux et celles qui sont déjà les mieux dotés. Ce n’était pas n’importe quel type d’ouvrier qui pouvait devenir candidat ou représentant du parti. Malgré tout cela a produit des effets importants. La représentation des ouvriers à l’Assemblée nationale jusque dans les années 1970, quand le PC était fort, était sans commune mesure avec ce que l’on connaît aujourd’hui. Ce volontarisme pouvait, pour partie, payer. On retrouve les deux points que j’évoquais précédemment. Une volonté explicite de mettre en avant des leaders issus de la classe ouvrière et ce fort travail de formation militante. Je crois que c’est l’articulation des deux qui peut être reprise.

Est-ce qu’une approche d’intersectionnalité, d’imbrication de plusieurs luttes sociales (classe, genre, race), peut permettre la construction d’un nouveau bloc populaire à portée révolutionnaire? Si oui, sous quelles conditions?
Vaste question. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’est pas possible de faire comme si ces rapports sociaux-là n’étaient pas fondamentaux, déterminants. C’est aujourd’hui, pour une gauche conséquente, une forme de préalable.
Ensuite, à rebours de ce qu’on entend parfois, prendre en compte ces rapports sociaux dans leur diversité n’est pas une stratégie qui est vouée à la défaite. C’est ce que montre bien Tristan Haute dans son chapitre sur l’hypothèse d’un quatrième bloc, le bloc abstentionniste. Il y a une frange significative d’électeurs qui ont des valeurs progressistes – y compris sur les questions de genre ou d’antiracisme -, mais certains d’entre eux ne votent pas régulièrement. Il y a donc un potentiel électoral majeur pour une offre politique de gauche conséquente, qui se situe au croisement d’un agenda de redistribution sociale et de prise en compte des dominations intersectionnelles. Une offre politique de cette nature n’est pas nécessairement vouée à perdre, à faire partir des millions d’électeurs du côté du RN, comme on l’entend parfois. Au regard des valeurs qui habitent une partie de l’électorat abstentionniste, il y a moyen de construire des victoires à partir d’une offre politique de cet ordre-là. Néanmoins, cela ne semble pas suffisant. Il faut encore élargir le spectre pour construire un bloc populaire. Il y a un enjeu à faire le plein du côté des catégories populaires et à constituer des alliances avec des classes moyennes, avec certains secteurs de la jeunesse, avec des travailleurs intellectuels précarisés.
Au-delà de cela, à titre personnel, le changement social ne peut se concevoir à partir d’une lecture strictement électorale. La prise de pouvoir est un enjeu important, mais si elle n’est pas arrimée à des mobilisations sociales d’ampleur, on peut faire l’hypothèse qu’elle ne déboucherait pas sur grand-chose. Le cas grec est intéressant de ce point de vue-là. La gauche radicale est parvenue au pouvoir, mais il y a eu une telle mobilisation du mur de l’argent en face qu’elle a dû se coucher devant l’UE. Dans le contexte français, avec l’exemple actuel de la mobilisation du patronat contre la taxe Zucman, qui est pourtant quelque chose de tout à fait modeste, une victoire de la gauche de rupture impliquerait une réaction très forte. Celle-ci ne pourrait être contrée qu’à condition d’un mouvement social d’ampleur. Or celui-ci doit se construire dans la durée, au-delà des seuls enjeux et échéances électorales. Et ces stratégies extra-électorales peuvent s’appuyer sur la convergence entre différentes luttes, différents rapports sociaux – classe, genre, race -, aspirations à la fois au partage des richesses et à des formes d’égalité dans tous les domaines de la vie sociale.
Propos recueillis par Jonathan Baudoin
Julien Talpin est sociologue, maître de conférences à l’Université de Lille, directeur de recherches au CNRS. Il est l’auteur de: La colère des quartiers populaires. Enquête socio-historique à Roubaix (PUF, 2024); La France, tu l’aimes mais tu la quittes (avec Olivier Esteves, Alice Picard, Seuil, 2024); Communautarisme ? (avec Marwan Mohammed, PUF, 2018)


Il faut attendre la toute fin de l’ entretien pour que soit abordée, » du bout des lèvres « , la question essentielle, celle de l’ articulation entre processus électoral et mobilisation. Imaginons une victoire électorale de la vraie gauche: elle sera immédiatement confrontée à une contre-offensive de l’ oligarchie capitaliste, de ses représentants politiques et médiatiques. Comment penser stratégiquement les tempêtes qui vont s’ amonceler au-dessus d’ un pouvoir de gauche? Que va-t-il se passer au moment où les institutions de l’ UE et toute la valetaille eurocratique vont « convoquer » JLM ou X ou Y pour lui signifier que le programme de la gauche c’ est Niet, qu’ il est contraire aux traités européens ?Nous savons qu’ aucun » changement » de l’ UE n’ est possible, et qu il n’ y a donc qu une possibilité : que notre pays entame une sortie de l’ UE. Comment on fait, comment on articule mobilisations de masse en France, mais aussi dans toute l’ Europe ( car l’ arrivée au pouvoir d’ une gauche de gauche suscitera necessairement de l’ espoir et ne manquera pas de faire éclore des mobilisations dans d autres pays) et affrontement avec les exécutif européens?
L’ oligarchie » nationale » et européenne va utiliser l’ artillerie lourde, tous les moyens à sa disposition pour bloquer le pays et empêcher le début d’ un processus de rupture avec le capitalisme. Les défis auxquels devra faire face un pouvoir de gauche seront immenses et j’ ai le sentiment ( peut-être par ignorance des travaux militants et/ou savants sur la question) que nous sommes bien prépares à la bataille électorale, mais assez peu à ce qui suivra…