Avec « La Déprise. Essai sur les ressorts intimes de la désobéissance » (éditions du Seuil), la psychanalyste Clothilde Leguil poursuit sa réflexion sur l’amour au temps de #MeToo entamée avec « Céder n’est pas consentir » et « L’ère du toxique« , tous deux parus aux PUF. Elle part cette fois de la bonne rencontre, celle qui fait événement et invalide toute idée de contrat de consentement amoureux. Où il apparaît que si s’éprendre, c’est se déprendre, c’est aussi entrer en désobéissance pour ne pas « céder sur son désir ». Entretien par Anne-Sophie Barreau
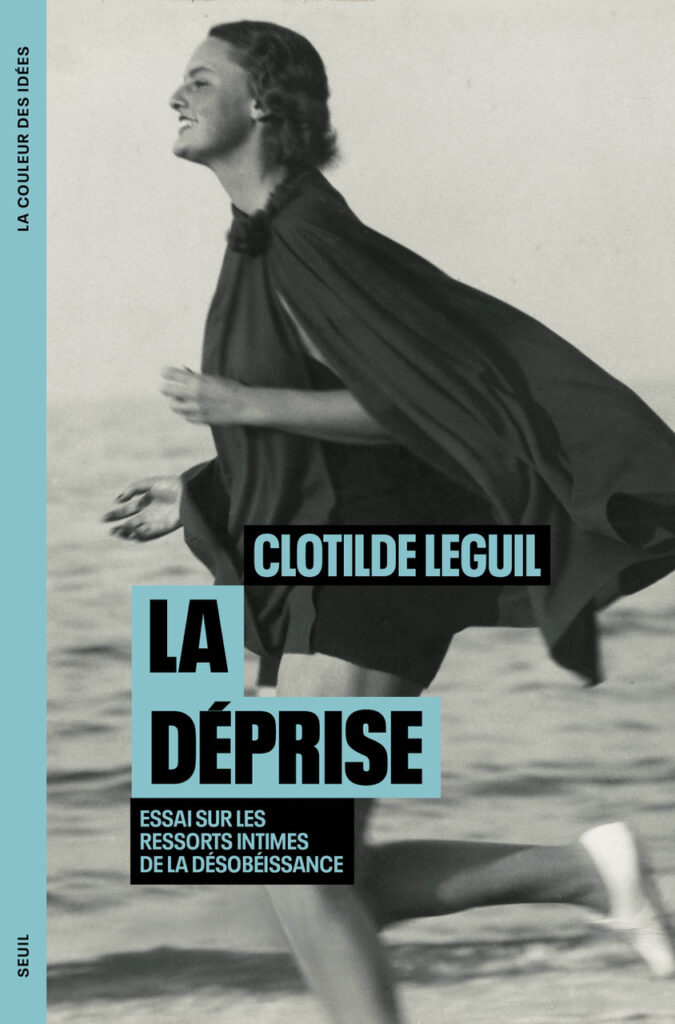

Quelle est cette déprise, que l’on entend comme l’envers de l’emprise, qui donne son titre à votre livre ?
Quand on entend le mot « déprise », on pense en effet spontanément à l’antonyme d’emprise. Le point de départ de ma réflexion était d’aborder l’emprise du point de vue de l’obéissance, quand un sujet en vient à ne plus pouvoir désobéir à ce qui s’impose à lui comme un commandement venant d’un autre ou un commandement intérieur. Ce qui m’intéressait, c’était la déprise impossible au fond. Mais cheminant dans ma réflexion, je me suis aperçue qu’il était difficile de penser l’emprise sans partir de la question du désir et du fait que celui-ci est toujours capté par le désir de l’autre. Le premier sens du mot déprise, c’est se déprendre de soi en faveur d’un autre, s’ouvrir à la rencontre, à l’événement amoureux, ne plus se murer derrière une position narcissique. C’est en partant de ce premier sens que j’ai trouvé mon élan pour questionner l’événement amoureux.
Il s’agit ici de l’événement amoureux au sens de la bonne rencontre, non de la mauvaise sur laquelle vous avez aussi écrit…
Suite au mouvement #MeToo, j’ai en effet beaucoup travaillé sur la question du forçage du consentement et de la mauvaise rencontre. Se mettre, comme je le fais ici, à l’endroit de la bonne rencontre, me permet de battre en brèche l’idée selon laquelle toute rencontre comporterait nécessairement un risque d’assujettissement et d’abus. Je suis repartie de l’événement amoureux pour creuser un écart entre les mauvaises rencontres, celles qui confrontent à une imposition de jouissance forcée et instrumentalisent le désir, et le caractère toujours inattendu de la bonne rencontre. Remplacer le consentement par un contrat s’apparenterait à une autre forme de forçage, comme si la rencontre amoureuse pouvait être de l’ordre d’un calcul. L’événement amoureux, c’est justement ce qu’on ne maîtrise pas, ce qui vient faire coupure dans l’histoire, ce qui permet de redéfinir le sujet comme un être qui se laisse bouleverser et pas seulement un être néo-libéral qui chercherait à savoir à l’avance ce qu’il va gagner dans une rencontre.
Dans cette première acception de la déprise, quels sont les ressorts intimes de la désobéissance ?
Consentir à l’événement amoureux, c’est toujours désobéir à certaines normes qui se sont imposées à nous, à une certaine idée de ce que devrait être notre partenaire, à un certain idéal… Si on parle depuis l’inconscient, c’est aussi désobéir à quelque chose de l’ordre d’une destinée qui ferait que tout se répéterait selon le même programme. Il s’agit de penser l’événement amoureux comme étant de l’ordre d’une surprise qui nous conduit à nous déprendre d’un certain rapport au Surmoi mais aussi aux normes du moment. Pour essayer de radicaliser cette idée, je me suis aussi appuyée sur 1984 de George Orwell. La rencontre entre Winston et Julia, les deux protagonistes, dans ce régime où tout est interdit, suppose un acte de désobéissance.

Vous venez de citer « 1984 ». Votre livre fourmille d’exemples empruntés de la littérature…
Il y a d’un côté les hypothèses que j’ai voulues défendre, celles par exemple sur le consentement à l’événement amoureux qui n’est jamais seulement libre et éclairé mais expérience d’un bouleversement subjectif, et de l’autre, une plongée dans les textes de la littérature classique. On ne peut pas en effet parler du discours amoureux uniquement conceptuellement. J’ai laissé ces textes remonter en moi, comme par exemple, cette scène du Tartuffe de Molière où les deux amoureux disent exactement le contraire de ce qu’ils pensent pour faire en sorte que l’autre se dévoile. J’ai voulu montrer que le discours amoureux désobéissait déjà au niveau de la langue elle-même au sens commun. Comme le disait André Breton, « les mots font l’amour ». C’est très beau. La formule donne d’ailleurs son titre à un chapitre. On est du côté de quelque chose qui anime le corps et rend joyeux. Dans le discours amoureux, les mots font l’amour sans que cela réponde à aucune utilité. On pourrait aussi citer les mots de Lacan qui dit que l’amour est « un caillou riant dans le soleil ».
Il y en un autre versant de « la déprise », celui que vous évoquiez au début de cet entretien, quand un sujet en vient à ne plus pouvoir désobéir. Pouvez-vous nous expliquer?
Il peut en effet y avoir une expérience de renversement. La déprise est d’abord de l’ordre du consentement à l’événement amoureux, puis dans un second temps, elle implique de pouvoir s’extraire de ce qui viendrait mettre en péril le désir. C’est ce second sens qui permet de penser cette dialectique de l’obéissance et de la désobéissance impossible. J’ai d’abord voulu explorer les raisons pour lesquelles un sujet féminin notamment pouvait vouloir « faire un » avec l’autre au point de céder à une pente sacrificielle. Cet angle m’a intéressée parce que c’est une question que pose déjà Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe. Elle pose cette question de façon politique, depuis la nécessité d’accéder à une forme d’égalité et de réciprocité dans la relation. Mais du point de vue psychique, les choses peuvent être plus compliquées. Lacan définit une sorte de jouissance féminine dans l’amour qui peut conduire à chercher à se définir à tout prix depuis le désir de l’autre au point de s’y perdre.
Du côté masculin, vous mettez plutôt en avant des figures qui ne peuvent pas se déprendre en faveur de l’événement amoureux, à l’instar du Vicomte de Valmont. Que nous apprend cette figure?
Le Vicomte de Valmont dans Les Liaisons Dangereuses de Choderlos de Laclos est un très beau personnage pour interroger la question de la différence entre le désir et la jouissance, et penser la question de l’obéissance. Il est divisé entre l’événement amoureux, sa rencontre avec Madame de Tourvel, et cette croyance dans le libertinage comme étant le mode de vie lui garantissant d’être maître de la jouissance. Il est confronté à ce qu’il y a d’illusoire dans le libertinage. Le leurre se redouble d’ailleurs à différents niveaux. Au départ, quand il lui écrit, il pense qu’il fait semblant de tomber amoureux de Madame de Tourvel, elle n’est dans son esprit qu’une proie qu’il va ramener comme un trophée à la marquise de Merteuil, mais finalement, les mots finissent par faire l’amour, et il ne maîtrise plus rien.

dans « Les Liaisons Dangereuses » de Stephen Frears en 1989
Pour questionner la désobéissance, vous revenez aussi à la racine du mot désobéir…
En effet, car ce questionnement implique aussi de savoir à quoi on obéit d’un point de vue inconscient, or l’étymologie d’obéir, nous apprend que obéir, c’est ouïr, « prêter l’oreille à ». Cette étymologie m’a permis d’interroger l’impossibilité de désobéir chez certains. Si on définit le sujet comme un être rationnel et autonome, qu’il suffit d’éduquer pour qu’il puisse désobéir à ce qui vient enterrer son désir, on ne comprend pas pourquoi il peut y avoir une désobéissance impossible. La voix est ce qui entre en nous sans notre consentement, elle s’incorpore, et cette incorporation permet peut-être de saisir pourquoi la question de la désobéissance suscite une angoisse au sens où le sujet est comme paralysé, et ne peut franchir en lui-même quelque chose qui s’impose comme un commandement.
Comment ce franchissement est-il malgré tout possible ?
C’est une traversée. Quand on est confronté à la question de ce qui exerce une emprise sur notre être, cela implique un déchiffrement qui n’est pas sans rapport avec l’expérience de la psychanalyse. A la fin du livre, je propose d’ailleurs de penser l’expérience de l’analyse comme une déprise. L’expérience analytique conduit à se déprendre de ce que Lacan appelle le « Dit premier », ou l’oracle qui serait venu me marquer et me conduirait à obéir sans le savoir à une forme de destin.
Une héroïne a su désobéir: l’épouse de Barbe-bleue.
Le conte de Barbe-bleue est magnifique sur la question de la désobéissance. Sur un ton menaçant, Barbe-bleue dit à sa jeune épouse qu’elle peut aller où elle veut dans le palais mais qu’elle n’a pas le droit d’entrer dans le cabinet secret. Pourtant, elle désobéit à cette voix parce qu’elle veut savoir à qui elle a affaire. Elle est angoissée mais elle franchit le point d’angoisse, c’est ce qui la sauve.
Comment comprendre l’affirmation de Lacan, que vous reprenez à votre compte, selon laquelle il ne faut pas céder sur son désir ?
Le consentement à l’événement, s’il introduit du nouveau, ne s’arrache pas depuis un sujet qui serait une page blanche. Le sujet est déjà marqué par son histoire, par des expériences traumatiques aussi. Quelque chose le rattrape nécessairement du côté de ce qui peut se répéter et que la rencontre ne suffit pas à faire cesser. Elle l’a fait cesser dans l’instant mais ensuite cet événement est comme recouvert par cette répétition. Lacan propose cette phrase pour penser un rapport au désir qui serait éthique. Ne pas céder sur son désir ne veut pas dire imposer sa pulsion à l’autre, mais ne pas céder à la pulsion de mort et sauver le désir qui est aussi puissance d’agir.
Comment cette phrase résonne-t-elle aujourd’hui ?
Elle invite à distinguer entre ce qui n’est que déchaînement pulsionnel et ce qui relève de la valeur du désir en tant que le désir fait limite à la pulsion. Cette phrase propose donc de se rendre responsable de son désir, et peut-être qu’elle esquisse pour notre époque une nouvelle éthique amoureuse.
Propos recueillis par Anne-Sophie Barreau

