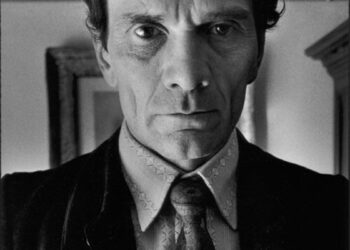De la nécessité des idéologies politiques
Le 06/03/2025 par Harold Bernat

La désidéologisation du politique n’est pas une avancée, mais une stratégie qui fragmente les opinions et empêche la prise de conscience des conflits sociaux. Derrière l’illusion d’une pensée neutre, elle isole les individus en les privant de repères idéologiques. Harold Bernat appelle à réhabiliter les idéologies comme outils essentiels de structuration et d’engagement politique.
J’entends ici défendre les idéologies politiques contre la bouillie qui se voudrait apartisane. Si l’on parle souvent de dépolitisation pour s’en lamenter, la désidéologisation du politique serait toujours une bonne chose. Est-ce vrai ? Nous pouvons y voir au contraire une manipulation de plus haut niveau, une stratégie d’effritement et de particularisation des opinions politiques qui nous empêche de nous situer dans une conflictualité sociale réelle. Comme le remarque très justement Georges Lukacs dans Ontologie de l’être social, L’idéologie, L’aliénation (Paris, Delga, 2012), « l’existence de conflits sociaux, la nécessité de les livrer d’une manière ou d’une autre, par les idées ou la propagande, demeure une nécessité sociale irrévocable, même dans le contexte de la manipulation la plus étendue et la plus organisée. » En d’autres termes, tant qu’il y a des conflits sociaux, il doit y avoir des idéologies pour les signifier. La désidéologisation n’est jamais totalement accomplie. Pire, il s’agit d’une mystification qui empêche les hommes de se situer socialement, collectivement. La fonction de cette entreprise, à l’heure de la manipulation de masse, consiste à ne s’adresser qu’à l’homme particulier, justement revenu de toutes les idéologies. On flattera chez cet homme « l’esprit critique » ou « le bon sens », « l’expérience personnelle », « le vécu », « pour ne solliciter chez lui», ajoute Lukacs, « que des instincts relevant de sa particularité ». Par ici les grandes gueules avec leurs avis tranchés qui n’engagent qu’eux-mêmes. L’efficacité pragmatique du manager cynique fera bon usage de cet effritement égotiste et de ses soi-disant « grandes gueules » contre les défuntes idéologies. « Nous ne sommes pas des idéologues » – autrement dits des « extrémistes » – « mais des pragmatiques réalistes à grandes gueules ». Voilà le credo des managers de vacuité politique qui pullulent sur tous les supports de la manipulation de masse. La manipulation est d’autant plus massive qu’elle s’adresse à des particuliers incapables de se situer collectivement. Incapable de comprendre la position de leur discours. Là est le ressort essentiel de la désidéologisation ou du « en même temps » pour faire référence à la bouillie macroniste qui aura fait tant de mal en France dans une situation inédite de décomposition du politique. Le spectacle médiatico-politique en raffole.
J’appelle par conséquent, dans ce texte, idéologie l’ensemble des représentations que mobilisent les hommes engagés dans une conflictualité sociale afin de s’imposer à d’autres. L’idéologie n’est pas seulement l’idéologie de la classe dominante ou une fausse représentation du monde, son image renversée dans un miroir. L’idéologie, dans son acception la plus universelle, est une arme de combat susceptible d’influencer l’univers mental d’autres individus. Dire d’un homme qu’il est un idéologue pour le réfuter sans autre forme de procès présuppose que l’on puisse soi-même échapper à la dite qualification. C’est certainement l’ambition du philosophe qui fait des yeux doux aux fameux « experts scientifiques », ce n’est pas celle d’un homme engagé dans le combat politique. Tout homme engagé dans un combat politique se comporte en idéologue, il fait œuvre idéologique. Il est par conséquent en droit d’assumer une idéologie politique. L’idéologie représente bien une réalité sociale. Il est donc faux d’interpréter cette notion dans un sens uniquement péjoratif.
Une attitude inverse consiste à penser que l’on peut s’affranchir des idéologies politiques et des contradictions qui sont inhérentes à la conflictualité idéologique. Pierre Bourdieu parlait, dès 1986, de « l’idéologie de la fin des idéologies ». Je préfère parler d’une idéologie du déni de la fonction sociale des idéologies politiques. La question est moins de savoir si nous sommes ou si nous ne sommes pas des idéologues que de comprendre ce qui distingue une idéologie d’une autre, en assumant pleinement la conflictualité sociale et ce qu’elle signifie quand on se la représente dans un combat politique.
Nous sommes situés et nous cherchons toujours à justifier notre situation. Qui ira reprocher au bourgeois bien né de justifier l’ordre social qui donne consistance à sa vie ? Il pense depuis son lieu. Cet état de fait est le lot de l’homme socialement situé et pas seulement le lot du bon bourgeois. Que celui qui n’a jamais cherché à justifier sa vie lui jette la première pierre ! Nous sommes pris dans des idéologies politiques car nous ne sommes pas des flottants vivant dans le pays de nulle part au milieu d’une société liquide et indifférenciée. Ces chimères publicitaires pour gogos sans ossatures sont réfutées pratiquement. Nous sommes en cela incapables de dissocier l’idéologie du combat et, au sens le plus noble du mot, de la polémique. L’idéologie s’exprime sur un champ de bataille. Dès que nous cherchons à imposer nos vues à d’autres, dans une situation de conflictualité sociale, nous faisons œuvre idéologique. La question est donc moins de savoir ce que j’affirme que contre quoi je l’affirme, contre quelle position idéologique suis-je en train de me battre.
Nous aimerions tous pouvoir nous prévaloir de la science pour éviter ce champ de bataille, sauf que la science n’est pas faite pour cela. Bien au contraire, l’objectivité scientifique cherche, dans ses domaines d’application, à sortir de la conflictualité sociale, autrement dit, pour reprendre le terme de Georges Lukacs, elle vise une forme de désanthropomorphisation. Les intérêts de l’homme ne sont pas son affaire. Est-ce vrai ou est-ce faux, là est la seule question en droit. Il n’y a pas d’héliocentrisme juif ou palestinien. Il n’y pas plus de photosynthèse urkrainienne ou russe. La science n’est pas le résultat d’une projection transfigurée des intérêts vécus de l’homme dans un champ spéculatif. L’image que l’homme se fait de lui-même est sans rapport avec la rotation de la terre autour du soleil ou l’activité moléculaire dans un brin d’herbe. Elle est sans rapport avec l’activité tectonique ou l’ensoleillement en Alaska. Par contre, pour comprendre la genèse d’une idéologie, il est absolument nécessaire de se plonger dans le monde vécu de celui qui la forme, qui la soutient, qui cherche à s’imposer à d’autres dans une situation de conflictualité sociale. La biographie dévoile bien souvent les ressorts idéologiques d’une position. Pourquoi tel individu a intérêt de défendre ce qu’il défend ?
L’explication des positions idéologiques revient toujours au monde vécu. Elle nécessite par conséquent une réanthropomorphisation permanente. Toutes les idéologies qui se prétendent scientifiques – le marxisme dit scientifique n’a pas échappé à cette tendance, l’économisme en a hérité – refusent cela. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elles nient toujours l’homme, sa sensibilité, sa vie quotidienne, sa réalité sociale, ce que Cieskowski nommera, dans ses Prolégomènes à l’historiosophie en 1838, quelques années avant Marx, sa praxis. Qui suis-je socialement ? De quoi je vis ? Où je vis ? Avec qui je vis ? Qu’est-ce qui m’anime au quotidien ? De qui je dépends ? Quels sont mes liens affectifs ? Quelles sont mes relations sociales ? Qui je sers ? D’où viennent mes représentations mentales ? Quels sont mes espoirs ? Quelles sont mes craintes ? Autant de questions concrètes à poser mais qu’il est plus juste de nommer des questions pratico-sociales. Il est assez facile de constater que ces questions sont rarement traitées pour ce qu’elles sont, à savoir des témoignages décisifs de notre inscription dans le monde social. En d’autres termes, nous traitons les idéologies politiques comme s’il s’agissait de théories scientifiques. Cela ne veut pas dire que nous établissons une égalité entre les deux. Cela signifie plutôt que nous avons tendance à oublier le type de vie humaine, le type d’homme, qui cherche à se justifier aux yeux des autres en s’inscrivant dans une idéologie, en la produisant ou en la faisant sienne. La question réellement subversive reste inchangée : qui et dans quelle situation sociale déterminée ? Qui se bat, qui meurt au front, qui vit dans la rue, qui se gave, qui cause à la télé, qui galère, qui souffre, qui n’a jamais la parole, qui est sommé de suivre ?
Nos vies, c’est une honnêteté préalable à avoir, sont striées de contradictions, d’échecs, d’inachèvements, de contradictions. Pratiquement, l’homme social, je n’en connais pas d’autres, est un être traversé par des contradictions insurmontables. Il vit avec jusqu’à son dernier souffle de vie. Ces contradictions viennent du dehors, de sa socialisation justement. Elles sont inhérentes à un état de développement historico-social. Il y a vingt ans, je n’affrontais pas, dans ma vie intérieure, les contradictions que j’affronte aujourd’hui. Ce changement est inhérent aux différentes modifications de mon inscription dans le monde, un monde lui-même en perpétuel changement. Nous ne cessons d’intérioriser les conflits du monde, de les intégrer à nos mondes vécus. C’est d’ailleurs pour cette raison que la fabrique de l’information, sa diffusion de masse, est à ce point décisive. Ce qu’on appelle, d’un mot générique, la question médiatique. Il est absolument naïf et faux de croire que l’information ne fait que nous informer, comme si un « je » détaché du monde pouvait recevoir ces données – on dit aujourd’hui ces data – sans que cela transforme profondément ses mondes vécues. Ce dont il est réellement question n’est autre que la colonisation des mondes vécus, celle des imaginaires, qui va jusqu’à l’impossibilité de pouvoir se dire, d’exprimer ses propres contradictions sociales. Tout est fait, dans l’écrasement de l’information, pour que la conflictualité idéologique ne fasse plus sens, n’aie plus lieu. Place aux particularismes, aux émiettements subjectifs, aux petites différences insignifiantes.
Nous avons tendance à penser faussement que l’idéologie est le principal problème, qu’il faudrait en finir avec les idéologies. Si l’idéologie, comme je le pense, est l’ensemble des représentations que mobilisent les hommes engagés dans une conflictualité sociale afin de s’imposer à d’autres, en finir avec les idéologies consiste à retirer aux hommes la possibilité de se battre. Avec elle, la possibilité de se dire, de se signifier. Il est absolument vital pour moi de pouvoir entendre ceux qui ne structurent pas leurs représentations du monde comme je le ferais moi-même mais qui font cet effort de structuration pour se dépasser eux-mêmes. Cela permet de comprendre d’autres mondes vécus, d’autres craintes, d’autres contradictions sociales. En retour, cela permet de se comprendre soi-même, de se situer tout en transformant ses propres représentations, de les affiner dans une dynamique qui se confond avec notre histoire. C’est l’ensemble de ce processus de transformation qui est nié lorsque l’on prétend se passer de toute idéologie. Cette chimère accompagne le devenir grégaire des ego qui se fantasment hors de toute idéologie. Les flottants.
Une des stratégies les plus terrifiantes politiquement consiste pourtant à faire croire que nous pouvons avoir une pensée objective du monde, que cette pensée est évidemment médiatiquement disponible à toute heure du jour ou de la nuit. Mieux, qu’elle nous dispense d’élaborer nous-même une représentation du monde social qui nous justifie. Cette pensée serait portée par des experts, des spécialistes, des figures d’autorité intellectuelles ou des grandes gueules, au choix. En France, pour accentuer le grotesque, ces figures se présentent parfois comme « philosophes ». Ces gens, contre les idéologues désignés – aussi nommés « militants politisés », « activistes de terrain », « journalistes engagés » – par la force supposée de « leur pensée » pourrait s’affranchir de toute idéologie politique. Des anges au-dessus de la mêlée. Les fameux penseurs à la française. Hors de toute pratique sociale, ces anges distribuent le vrai et le faux des pratiques sociales hors de toute pratique sociale comme le curé délivre des hosties à la messe. Le corps médiatique insituable. Amen. Sans savoir qui sont ces gens, nous voilà sommés de prendre leurs évaluations comme des données factuelles. Faire valoir une « idéologie » face à cette parole sacerdotale vaut excommunication et en définitive « extrémisme ».
Si l’opinion est à ce point versatile c’est qu’elle correspond à un moment de désarmement idéologique généralisé. Les ego flottent, incapables de relier leur être social – ils se fantasment sans lieu – aux représentations qu’ils se font d’eux-mêmes. En oubliant leur inscription sociale et les moyens de la signifier, ils ne sont plus que des baudruches hors sol accordant un crédit immédiat à des représentations contraires à ce qu’ils vivent pratiquement, contraires à ce qu’ils vivent quotidiennement. Si l’idéologie est toujours solidaire d’une dimension sociale de la pensée, la désidéologisation promue par le spectacle n’a, en définitive, qu’une seule fonction réelle : faire oublier le social et l’être social de l’homme. Une fois oublié son lieu social, celui qui peut se signifier dans une idéologie de combat, le public renvoyé à ses particularismes ne peut plus s’opposer. Dans un paradoxe qu’il convient de réaffirmer sans cesse, plus un jugement est développé moins il échappe à son inscription sociale, plus il est pratiquement vrai. Non pas au sens d’une vérité scientifique mais dans la mesure où il correspond à une vérité pratique. C’est justement ce que soutient Marx dans L’idéologie allemande lorsqu’il affirme que « la richesse intellectuelle de l’individu dépend entièrement de ses rapports réels. » Encore faut-il que ces rapports réels puissent être liés les uns aux autres. Les idéologies permettent cela, elles structurent en nous faisant sortir du particularisme.
Les idéologies politiques permettent de résister à l’émiettement des ego flottant dans des représentations éclatées. Elles situent une position et permettent d’engager un conflictualité qui reflète des affrontements sociaux réels, des conflits d’intérêts manifestes. Pour parler d’idéologie, il faut que l’idée particulière se dépasse elle-même jusqu’à acquérir une dimension sociale et collective. Il s’agit bien d’une transcription en idées d’une réalité pratique. L’idéologie bourgeoise n’est pas une vue de l’esprit mais un ensemble structuré de représentations sociales qui ordonnent la vie sociale du bourgeois. Quand un bourgeois vous parle de la guerre qu’il ne fera pas lui-même, il s’inscrit dans une idéologie qui le dépasse. C’est cela qu’il convient de penser. Pourquoi une classe sociale si peu héroïque, si lâche pratiquement, a-t-elle besoin de recourir à cet héroïsme d’emprunt ? Engels pose la question dans l’Anti-Dürhing. Sa réponse est cinglante. Pour Engels, l’héroïsme militaire, les grandes valeurs martiales de la République romaine ou l’abnégation désintéressée sont « les illusions dont les bourgeois ont besoin pour se dissimuler à eux-mêmes le contenu étroitement bourgeois de leurs luttes et pour maintenir leur enthousiasme au niveau de la grande Tragédie historique ». Il n’y pas de fin des idéologies car il n’y a jamais de fins des intérêts sociaux. Pour affronter cette idéologie de dissimulation des idéologies sociales, il faut à notre tour assumer la dimension idéologique de notre position. Cela ne nous dispense pas d’avoir vis-à-vis de nos propres représentations politiques une dimension critique et réflexive. Mais il faut comprendre qu’il n’y a pas de positions immaculées, il n’y a pas de positions en surplomb. C’est justement cette manipulation qui extermine aussi bien la critique que le politique. Nous sommes toujours situés et nous avons toujours besoin de nous signifier dans une conflictualité sociale. De ce point de vue, dans une manipulation de masse qui recherche avant tout à conforter les ego grégarisés dans leur opinions incohérentes et dissociées, le discours de la fin des idéologies politiques est le plus faux qui soit. Contre lui, travaillons à signifier des oppositions idéologiques réelles qui correspondent réellement à nos pratiques sociales, à ce que nous sommes, à ce que nous vivons. Retrouvons le sens des contradictions idéologiques. L’habitude de nous mouvoir dans des représentations totalement absurdes fait que les contradictions réelles finissent par ne plus avoir de sens. Sans contradictions pensées, la politique – et avec elle la démocratie – n’a strictement plus aucun sens. Nous y sommes.