La bourgeoisie n’a plus les moyens intellectuels, ni culturels, de sa domination de classe
Le 17/02/2025 par Harold Bernat

Une crise sans précédent de la culture de classe est en train de se dérouler sous nos yeux. Cette crise emporte aujourd’hui aussi bien la gauche que la droite, si l’on veut absolument en revenir à des repères simplistes. La classe sociale dominante jouit, mais ne pense plus, ne crée plus. Elle n’a plus qu’un chantage à proposer au peuple : en dépit de notre nullité, si nous ne sommes plus là, que vous restera-t-il? Ce n’est pas que des « populismes » aient poussé spontanément pour menacer l’ordre social en faisant peser la menace du chaos et de l’anomie. Ces mythes réactionnaires ne sont que des aveux d’impuissance, et voici pourquoi. Un nouveau grand texte d’Harold Bernat, agrégé de philosophie et collaborateur de « Quartier Populaire », à lire aujourd’hui sur QG
Longtemps la culture de classe, une culture bourgeoise, a fait le travail pour tenir les hommes en respect et créer les conditions d’une humanisation partagée. Nous assistons pourtant, particulièrement en Europe, spécialement en France, à son exténuation. Une révolution culturelle à bas bruit est en train de tout emporter. Aussi bien l’humanisme abstrait issu des Lumières que le romantisme de réaction, à la fois les philosophies bourgeoises de l’arrachement à la nature que les philosophies bourgeoises de la renaturalisation de l’homme dans une histoire, une langue, une culture. En un mot, une crise sans précédent de la culture de classe dans sa fonction pratico-sociale d’institution des sociétés humaines. Cette crise emporte aussi bien la gauche que la droite pour ceux qui aiment les petits repères simplistes. Mes repères seront Kant et De Maistre.
Culture de masse, culture populaire, culture mondaine, culture de cour, culture artistique, culture du génie, culture humaniste, culture romantique, nous parlons toujours d’une culture de classe qui tenait en respect les hommes et les peuples. Culture pourvoyeuse de sens, de significations imaginaires, d’un ordre socialisé. Tordons d’abord le cou à une croyance naïve qui consiste à penser qu’il existe une culture populaire spontanée et autonome qui ne serait pas une culture de classe ou que cette culture populaire serait écrasée, inhibée, par une culture de masse tombée du ciel de l’industrie culturelle elle-même produite par une classe dominante. Il n’y a pas et il n’y aura jamais de culture spontanée qui émanerait de la terre qui ne ment pas ou de l’esprit d’un peuple spontanément disponible pour une transcription littérale. Comme si la culture n’exigeait aucune maîtrise, aucun travail, aucune exigence, aucune verticalité. La culture serait, dans sa généalogie populaire, d’ailleurs largement mythifiée par la réaction à l’humanisme abstrait, une force disponible depuis le bas. Elle pousserait en continu, fond obscur localisé géographiquement et historiquement mais impensable rationnellement. Ce mythe feint d’oublier que la culture procède toujours du haut vers le bas, elle est descendante.
Arnold Hauser a pu établir, en 1974, dans un excellent livre intitulé Fondements de la sociologie de l’art, qu’aucune forme d’art n’était réellement collective et d’emblée socialisée. Il en va de même de la création culturelle. Chaque forme culturelle particulière prend sa source dans une création individuelle qui se déploie ensuite dans une communauté qui peut se l’approprier a posteriori. La faire sienne. Ce n’est pas parce que l’auteur d’une chanson populaire est anonyme qu’il n’est pas issu d’une classe sociale lettrée. Hauser explique par exemple que le « genre épique populaire » était le fait d’érudits. Il en va de même pour les idylles du Moyen-âge ou les recueils de proverbes dits « populaires ». Comme le rappelle Juan José Sebreli dans La modernité assiégée, Critique du relativisme culturel (Delga, 2020), cette compréhension de classe a prévalu dans toutes les cultures. « La sculpture africaine – tant vantée par les populistes – fut anonyme et là aussi non spontanée ; les sculpteurs noirs appartenaient à des castes consacrées au métier. » Seul le regard colonialiste sur ces œuvres a pu y voir l’expression d’un primitivisme spontanéiste. La plupart de ces œuvres étaient d’ailleurs contemporaines des collectionneurs parisiens, surréalistes, marchands d’art, amateurs alors qu’ils y voyaient l’expression naïve et innocente d’une humanité disparue. Méprise d’une classe qui ne peut pas reconnaître chez l’autre la même logique de classe sans se juger elle-même. Effet miroir pour mieux se persuader qu’il est toujours possible de saisir la culture à son état natif, originaire, primitif. La mauvaise conscience bourgeoise fantasme l’altérité pour s’oublier elle-même. Elle rencontre en réalité d’autres hiérarchies, d’autres verticalités. Une autre culture de classe. Illusion ethnocentrique et incompréhension de la logique de classe de la création culturelle. En d’autres termes, la culture, celle qui donne un sens à nos vies humaines, celle qui structure nos existences, « populaire » ou « élitiste », celle dont on ne peut pas se passer sous peine de dépérir, procède toujours du haut vers le bas. La culture est descendante. Ce n’est ni un mal, ni un bien mais un fait anthropologique. La question est donc de savoir ce qui descend encore quand la classe dominante est culturellement exténuée.
La compréhension de ce fait anthropologique fondamental est essentielle pour saisir la crise de la culture de classe qui est en train de déployer toutes ses conséquences politiques en Europe. Lorsque nous parlons des Lumières, de l’universalisme, d’humanisme ou de la réaction aux Lumières, de romantisme, de particularismes culturels, nous nous situons toujours dans une culture de classe descendante. Kant et De Maistre étaient des bourgeois et leur représentation du monde une représentation de classe. Cela ne veut pas dire qu’ils pensaient mal. Le premier envisage l’homme dans sa capacité originaire à s’arracher à tout particularisme culturel pour signifier son humanité, le second ne pense l’humanité que dans son attachement à des particularités culturelles. Fer de lance de la réaction en France à la fin du XVIIIe siècle, ce dernier écrit, dans ses Considérations sur la France en 1796 : « J’ai vu, dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes etc. Je sais même grâce à Montesquieu qu’on peut être Persan mais quant à l’homme, je déclare ne jamais l’avoir rencontré de ma vie ; s’il existe, c’est bien à mon, insu. » Les deux présupposent une culture qui puisse faire sens pour l’homme en tant qu’homme (Kant) ou l’homme en tant que Français, Italien, Russe, pour de Maistre. Tous deux produisent des représentations culturelles extrêmement sophistiquées de l’homme. Ils œuvrent pour donner un sens à la vie humaine. Il est évidemment possible de défendre l’héritage des Lumières et l’humanisme abstrait contre la réaction et l’humanité située, voire de composer dialectiquement avec les deux, ce qu’essaiera de faire Hannah Arendt dans La crise de la culture mais dans les deux cas nous avons affaire à une classe sociale qui n’est pas indifférente culturellement à l’édification d’un sens pour l’homme, une classe sociale bourgeoise qui fait de la question de l’homme une nécessité pour elle, une classe qui œuvre.
Il ne faut pas regretter ce fait social mais partir de lui pour comprendre que l’effondrement anthropologique dont nous parlons aujourd’hui et exclusivement l’effondrement des capacités de la classe dominante, bourgeoise en l’occurrence, à produire encore des individualités capables de créer une culture susceptible d’organiser nos significations sociales, de leur donner un sens. La classe sociale dominante est désoeuvrée. Elle jouit mais ne pense plus, ne crée plus rien. Ce n’est pas que sa parole ne soit plus entendue comme elle cherche pourtant à nous le faire croire. Ce n’est pas non plus que des « populismes » soient sortis spontanément du siècle pour menacer l’ordre social en faisant peser la menace du chaos et de l’anomie. Ces mythes réactionnaires, car ce sont des mythes en réaction d’une impuissance propre, ne sont pas destinés aux peuples qu’ils semblent viser. Ce sont autant d’aveux d’impuissance. « Ne pouvant plus faire descendre une quelconque culture du haut vers le bas, étant incapables de signifier quoi que ce soi, étant engagés dans un survivalisme indifférents aux domaines de l’homme, nous ne pouvons que nous défier brutalement de ce qui nous menace. » Voilà ce qui devrait être énoncé par cette classe qui n’assume plus son rôle, pire, qui en est intellectuellement incapable. En France, elle a cherché à promouvoir une imposture en « président philosophe ». Elle sent en effet confusément que les références qui ont pu lui donner la légitimité d’une domination indiscutable lui échappent désormais. Elle recycle par conséquent les signifiés des Lumières, de la philosophie mais il n’y a plus rien derrière. Le néant. Tout un appareil médiatique est alors nécessaire pour promouvoir ce simulacre dans le temps, le faire tenir. Mais cela ne tient pas, cela ne tient plus. Le « président philosophe » n’était qu’une gidouille grotesque.
Il faut bien comprendre que la bourgeoisie de connivence, nous parlons d’elle, n’a plus que des dadais incultes à offrir en spectacle pour armée de réserve. Elle n’a plus les ressources intellectuelles de sa prétention sociale à la domination. Elle n’est plus capable de gagner, par sa force culturelle propre, sa légitimité politique et sociale. Ne lui reste que la brutalité. Cette impuissance manifeste est évidemment la raison première d’une surenchère défensive de la part de bourgeois culturellement stériles. Cette brutalité est un symptôme. Il s’agit même du symptôme le plus manifeste d’une classe qui a perdu toute vocation à gouverner.
Le phénomène premier est l’effondrement sidérant des classes dominantes. Culturellement, elles sont aujourd’hui incapables de faire ce qu’elles ont toujours fait : organiser la vie humaine en créant des significations imaginaires fécondes pour le plus grand nombre. Leur stérilité stérilise du haut vers le bas. Avec une haine farouche et une méticulosité d’experts, les classes sociales supérieures au pouvoir – ce mot en devient ridicule tant la misère spirituelle y est profonde et la corruption d’une bassesse odieuse – se sont évertuées depuis des années, des décennies, à détruire les espaces, les lieux, les supports qui rendaient possible la compréhension d’un problème qui nous concerne tous : sommes-nous encore capables de signifier ce qui nous arrive ? Avec Kant, De Maistre, Arendt, à ta guise. En guise d’économies justement, proposition vient d’être faite de fermer l’Université de Bordeaux-Montaigne, une semaine en mars 2025. Nous en sommes-là, en France. Cet exemple vaudra pour la myriade de destructions qui prend aujourd’hui le doux nom de progressisme. Il se trouve que le macronisme, cette bouillie salement managériale et prédatrice du commun, cornaquée sans direction par des drogués d’eux-mêmes, n’a fait qu’accélérer la tendance. Ces agents spécialisés du vide demandent encore, dans une fuite en avant qui signe leur démence, un surcroît d’accélération dans le vide. Au nom de l’Europe, de la paix ou des jeux olympiques, allez savoir. La devise Shadoks est appliquée à la lettre : « quand on ne sait pas où l’on va, autant y aller le plus vite possible ». Si au moins ces turbo-zombies proposaient comme chemin à suivre une pataphysique joyeusement désespérée, il y aurait encore quelque chose à penser. La stérilité de cette classe donneuse de leçons la rend pourtant incapable en tout.
Entendons-nous bien. Il y a toujours eu et il y aura toujours des contradictions humaines et ce n’est pas à une classe qui vit aussi des contradictions sociales qu’elle exploite de les régler. Il y aura toujours malfaçon et l’existence de l’homme est de part en part tragique. La condition humaine est ainsi faite. Mais cette malfaçon doit pouvoir se dire, s’exposer, se penser. Toujours. Elle doit pouvoir, d’une époque à l’autre, ajuster ses institutions en fonction des représentations que l’homme se donne à lui-même. Avant d’accuser le « populisme » d’un tel, ou le « complotisme » d’un autre, avant de décider de ne pas penser, il est toujours préférable de se demander pourquoi le bas se défie à ce point du haut. Mieux encore, reste-t-il un haut ? Pour quelles raisons en sommes-nous là, à ce point de brutalité ? Pourquoi des hommes se retrouvent éborgnés alors qu’ils demandent à être reconnus en tant que citoyens ? Il y a bien adresse, demande, attente. Mais la réponse apportée par cette nouvelle classe du vide, culturellement stérile, ne vaut plus rien. Un monologue narcissique, un grand débat autour du nombril président, un pignolage, un néant. Ce n’est pas que les hommes ne l’entendent pas, c’est que la réponse n’est plus une parole. Elle ne fait plus sens, il n’y a donc rien à entendre. C’est un bruit de classe, un bruit de bouche, un bruit de bottes. Il ne s’agit plus de faire droit mais d’imposer son droit, dans le vide, sans justification. « Ordre, ordre, ordre ». Ordre d’un droit qui n’est plus que ordre.
Alors que faire ? Accepter cette révolution à bas bruits qui est en train de nous emporter vers un autre horizon. Nous situer déjà après elle, la dépasser. Pour reprendre le mot de Pasolini dans Les lettres luthériennes en 1975, « les mutations anthropologiques sont irréversibles ». Les mutations du capitalisme ont profondément transformé les classes dominantes et par conséquent les formes culturelles qu’elles ont pu produire. Il n’y aura pas de retour en arrière. Lorsque nous témoignons du vide brutal et de la bêtise obscène de ce qui est supposé occuper le haut de la stratification sociale, nous n’avons aucun espoir d’un changement de la part de ceux que l’on vise. La nullité des dadais de la bourgeoisie incestueuse n’a pas à être corrigée. Elle est fatale. Ce serait d’ailleurs se méprendre sur nos intentions réelles. Il s’agit plutôt d’intérioriser le constat de cette nullité historique, inédite, tout en faisant valoir, face à elle, ce qui est vital pour nous. Oui, cela surprendra les plus nihilistes et les plus résignés, les plus drogués et les plus faux, nous avons encore des exigences à faire valoir en face du vide et de la nullité. Peut-être avons-nous à apprendre à ne plus frémir devant ce vide de significations venu d’en haut. Nous avons encore du chemin à faire de ce côté-là. Comme si, habitués depuis trop longtemps à recueillir une culture produite par d’autres, nous n’arrivions pas vraiment à mesurer à quel point nous avons encore à expérimenter ce vide, à le parcourir, à le signifier, pour nous.
« En dépit de notre nullité manifeste, si nous ne sommes plus là, que vous restera-t-il ? » Tel serait le chantage warholien ultime de cette classe désoeuvrée. Ce chantage ne tient que par notre manque de force pour nous nommer, pour être nous-mêmes les dépositaires des signes susceptibles de nous signifier. C’est aussi ce qu’on appelle encore une culture de classe. La nôtre.
Harold Bernat



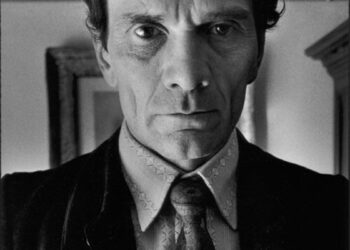
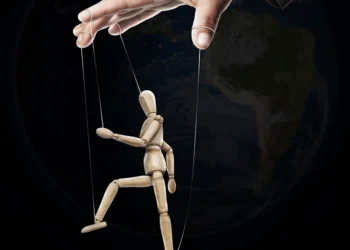
En écho très respectueux à cet article d’Harold Bernat, j’incline à porter à sa connaissance et à la connaissance d’éventuels lecteurs et lectrices l’existence d’un texte de Theodor W. Adorno, issu d’une conférence donnée en 1959 et publié la même année, intitulé :
« Théorie de la demi-culture »
(Theodor W. Adorno, Société : Intégration. Désintégration, Éditions Payot & Rivages, 2011, p.183-220.)