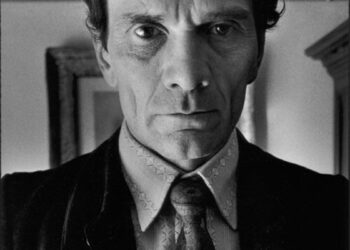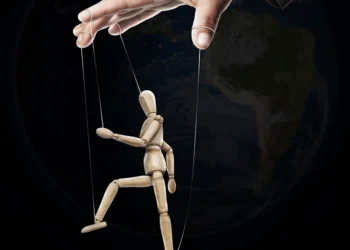« La corruption et le népotisme, quotidien du règne d’Emmanuel Macron »
Le 14/02/2025 par Harold Bernat

Sous la présidence d’Emmanuel Macron, depuis 2017, la corruption est devenue telle en France que l’impensable fait aujourd’hui partie de notre quotidien, et que les personnages les plus ouvertement vendus peuvent désormais s’imposer jusqu’à la tête du Conseil Constitutionnel. Quand l’État va mal, et l’État français va vraiment très mal, il est salutaire de faire un pas de côté pour prendre de la hauteur. C’est ce que propose notre ami et collaborateur Harold Bernat, membre de l’équipe « Quartier Populaire ». À lire ce week-end sur QG
La procureure de la cour d’appel de Rennes qui a classé sans suite l’épais dossier du magouilleur des mutuelles de Bretagne est membre du conseil constitutionnel depuis 2022. Le président annoncé de ce Conseil par Macron le faux ne serait autre que ce même magouilleur des mutuelles de Bretagne, Richard Ferrand, à qui elle doit sa place. Il était alors président de l’Assemblée nationale. La corruption et le népotisme sont tels que l’impensable fait aujourd’hui partie, en France, des affaires courantes. Quand l’État va mal, et l’État français va très mal, il est salutaire de faire un pas de côté pour prendre de la hauteur. Dans cette litanie de magouilles, plus invraisemblables les unes que les autres, dans une indifférence renforcée par une censure médiatique évidente, le risque est pourtant grand de ne plus chercher à comprendre avant de conclure : « l’État est pourri, rejetons l’État ».
Le jour de l’arrivée d’Hitler au pouvoir, Carl Schmitt écrit : « Aujourd’hui, Hegel est mort ! » Retraduisons-le: « À partir d’aujourd’hui, l’État, c’est nous. » Le juriste national-socialiste ne portait pas dans son cœur le grand dialecticien de Berlin qui avait pourtant formé, depuis sa chaire, l’élite de la philosophie allemande, parmi lesquels un certain Karl Marx. Juste après sa mort, en 1831, il sera vite remplacé par Schelling qui pensait, avec Schlegel, que l’État était fils de la métaphysique profonde enracinée dans l’esprit d’un peuple, le « Volk« . Schelling aurait sûrement acquiescé à cette sortir de Macron le faux en avril 2017: « La politique, c’est mystique« . Il faut bien comprendre que ces phrases insensée trouvent des échos dans l’Histoire. Elle ont en quelque sorte une paternité philosophique. Affirmer de la politique qu’elle est mystique, ou de l’État qu’il est fils de la métaphysique profonde, consiste à prendre une décision sur la notion même d’État. Le droit et la justice ne seraient pas les finalités de l’État. Ce dernier n’est en définitive qu’un instrument de puissance au service d’une élite inspirée qui ne sert pas l’État, mais se sert de lui. D’où la corruption, d’où le népotisme. L’État est un moyen pour les mystiques de la force ou, quelques effondrements plus loin, pour les incestueux arrogants des « promotions canapé » chargés de coke. L’État n’est pas une fin mais le moyen d’une jouissance qui a besoin d’écraser le peuple pour faire durer l’orgie.
Hegel est évidemment connu pour sa pensée de l’État. On lui prête une disparition de l’individu dans l’État, un écrasement de l’individu par l’État, une subordination radicale de la vie de l’esprit à celle de l’État. Il serait, pour la paternité, l’apologiste de l’État prussien. Pourtant, l’État prussien s’est vite empressé de le remplacer. Il faut croire que la Prusse historique de Frédéric-Guillaume IV et plus encore celle du troisième Reich n’avaient pas grand besoin de sa dialectique rationaliste de l’État. Wilhelm Liebknecht, co-fondateur du parti social-démocrate allemand, ajoute, en 1870, une note, sans en parler à l’auteur, sur un article de Engels consacré à Hegel. Hegel serait, selon lui, un fervent défenseur de l’État royal-prussien. Cette note attirera les foudres de Engels et Marx. Ce dernier écrira, le 10 mai 1870 : « Il ferait mieux de la boucler que de répéter ces vieilles âneries. » Même pour Karl Marx, Hegel n’était pas le philosophe de l’écrasement de l’individu par l’État prussien, même en 1870, 40 ans après sa mort. Finalement, les socio-démocrates et les juristes nationaux-socialistes n’aiment pas Hegel et sa théorie de l’État. Le philosophe de Berlin a aussi contre lui les mystiques, les romantiques débridés, les défenseurs du « Volk » ancestral. Il aurait aujourd’hui contre lui les cabinets de conseils parasites, les young leaders éventés et les tapineurs du Capital les plus faux. Pourquoi ? Et en quoi cette adversité chronique a un rapport avec la volonté de liquider l’État de droit ?
Pour Hegel, et cette définition nous concerne quand nous parlons de corruption de l’État, en particulier en France, l’État n’est pas un idéal ou une fiction politique. Il s’agit de l’être de l’homme réalisé en raison. Si, note Hegel, « la philosophie est son époque saisie par la pensée », l’État est la raison humaine saisit en elle-même. L’exigence est ici maximale ce qui, vous me l’accorderez peut-être, rentre en contradiction manifeste avec la nullité intellectuelle et l’arrivisme le plus crasse qui prétend pourtant le faire vivre de l’intérieur. J’ai nommé, en France, le macronisme dans son pourrissement terminal. L’individu, y compris chez Hegel, a toujours le droit de critiquer l’État ou de vouloir sa disparition. On peut le comprendre quand on observe l’étendue des dégâts sous nos latitudes tempérées. Mais il doit toujours, en raison, mesurer les conséquences de ce rejet. Quelle justice sans État ? Comment juger la corruption si l’État de droit n’est plus là pour assurer la mesure ? Que reste-t-il d’autre si ce n’est la violence ? On peut évidemment penser que l’État est contingent, que c’est une forme historique transitoire, qu’il n’y a rien à sauver. Mais, Juvénal nous le souffle, qui pourra alors juger les juges et Richard Ferrand par la même occasion.
On oppose trop souvent, par déficit de réflexion dialectique, par défaut chronique de cet enseignement dans le grand spectacle des options binaires montées en épingle pour le buzz du vide, l’individu et l’État. Ce serait ou l’un ou l’autre. L’un face à l’autre. En réalité, en effectivité écrivait Hegel, l’individu ne disparaît pas dans l’État, il s’y réalise en tant que personne humaine. L’État – nous peinons à penser cette idée aujourd’hui tant l’ego-grégarité fonctionne à l’identification primaire irréfléchie d’images aliénantes – est achèvement de l’homme. La politique n’est pas une mystique mais son exact renversement. C’est la science de la volonté et de la liberté réalisée. Il n’est pas de liberté dans l’absolu et la phrase de Macron, « sky is the limit », témoigne d’une pensée malade plus que d’une métaphore de la liberté. En cela, la liberté doit pouvoir volontairement s’affirmer dans les moyens de sa réalisation. Cette idée d’une réalisation de l’homme par le droit est absolument essentielle et c’est cela qu’il faut sauver. Non pas l’ordre du grand Moloch étatique qui n’excite que les impuissants ou les fous du Puy mais la satisfaction d’accéder à la personne humaine dans un ordre juste. Le droit et la justice appellent leur réalisation. C’est ainsi qu’il faut comprendre la distinction entre la personne humaine et l’ego-grégarisé qui demande des droits comme on hurle à la lune sans penser le dépassement de lui-même dans l’État, dépassement nécessaire pour que ces droits aient un sens. Pour Hegel, l’homme en tant que personne humaine est libre dans un État juste, garant des libertés publiques. En cela, la question de la liberté individuelle, n’en déplaise aux libertariens, est directement liée à la question de la réalisation de l’État. Nous touchons ici un des plus grands naufrages du populisme de gauche qui finit par s’abîmer dans une bouillie de libération sans ordre ni mesure. Le populisme de droite, lui, veut la trique identitaire. Une autre forme de renoncement à la raison. La libération ne peut être que celle de l’homme raisonnable qui ne considère comme décision réellement sienne qu’une décision universelle visant le bien commun. Ma liberté n’est réelle que dans un monde orienté vers la raison. L’État, avant d’être une institution séparée de l’homme, est avant tout la réalisation exigeante de cette idée. De ce point de vue, aucune liberté pensable ne peut exclure l’État. Le mépris typiquement libéral et post-moderne de cette idée accompagne la survivance des structures étatiques comme structures d’ordre et de sécurité. L’État n’est plus qu’une police. C’est le déjà fameux « ordre, ordre, ordre » du ministre de l’intérieur dont il est préférable, pour cause d’insignifiance, de taire le nom. Ne reste que l’égo-grégarisé dans un parcage sécuritaire, incapable de se sublimer moralement, condamné à l’idiotie. On peut toujours affirmer n’importe quoi et mettre n’importe qui au pouvoir mais le prix à payer doit être reconnu : rien, pour Hegel, ne pourra s’opposer aux violences de l’injustice. C’est ainsi qu’une société se désagrège.
Hegel, ce qui d’ailleurs le rapproche de Marx, se faisait une haute idée de la philosophie et de la politique. C’est certainement cela sa plus grande postérité. L’homme qui se fait citoyen et œuvre de toutes ses forces contre la dégénérescence de l’État réalise en lui la philosophie. Il ne s’aliène pas dans l’État mais cherche à se dépasser lui-même, à réaliser sa liberté. Il va de soi que si l’État se transforme, qu’il n’a plus rien à voir avec une quelconque réalisation de l’être de l’homme en raison, que la fausseté a fini par parasiter les institutions et qu’en guise de sages les pires magouilleurs sont promus, la résistance s’impose. C’est ici que Hegel n’est pas Marx. Comme le rappelle Eric Weil, dans une de ses conférences sur le professeur de Berlin, « Hegel a tenu sa place, il n’a pas voulu s’exposer à des désagréments. » Il distinguait pourtant les « hommes à principes » et « les hommes d’État » dans son essai sur le Reform Bill anglais. En nous exposant à des désagréments, peut-être devons chercher à sauver une idée de l’État qui est en train de disparaître sous les coups de butoirs des mystiques de la force et des ego-grégarisés. Pour cela, il nous faut des « hommes d’Etat », nous avons déjà les principes.
La liberté n’est pas une abstraction et c’est pour cette raison qu’elle nécessite le droit. Comme l’écrit Hegel dans cet essai décisif « la liberté formelle ne peut pas déterminer la liberté réelle. » Les droits de l’homme ne sont pas une politique, les grands principes universels non plus. Pas plus que l’anti-racisme, l’anti-fascisme ou l’anti-capitalisme. Ces principes doivent pouvoir s’aliéner dans une idée de l’État qui réalise l’homme au lieu de l’humilier. Si l’État n’est que l’État du capital, si nous sommes incapables de penser un État de droit qui ne soit pas autre chose qu’une continuation légalisée de la violence du marché, pire, si cet État n’est plus que l’autre forme de la violence naturelle, il faudra définitivement entériner la disparition du politique et de la philosophie. Citoyens d’un pays qui a ouvert une voie dans cette longue histoire, aujourd’hui mutilée au sommet de l’État, pouvons-nous accepter cette disparition sans lutter ? Nos places dérisoires suffisent-elles à justifier l’entendue de nos renoncements ? En sauvant l’État français, ne serions-nous pas en train d’essayer de nous sauver nous-mêmes ?
Harold Bernat