Bond en avant pour le chômage! Les données de la Dares du 27 janvier dernier indiquent une augmentation de 3,9% du chômage en France au dernier trimestre 2024. La plus forte hausse observée depuis 10 ans, hors Covid. Pour QG, l’économiste Christophe Ramaux, maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, explique cet échec patent par la politique de l’offre, renforcée sous Macron, et comprimant tout à la fois: la consommation des ménages, l’investissement privé et public, ainsi que les recettes publiques. Cette situation conduira selon lui la France vers une trajectoire de récession pour 2025, avec des faillites record à l’horizon, avec la fin du « quoi qu’il en coûte », et un creusement du déficit public profitant aux ménages riches, plaçant leur excès d’épargne dans la dette publique. Interview par Jonathan Baudoin

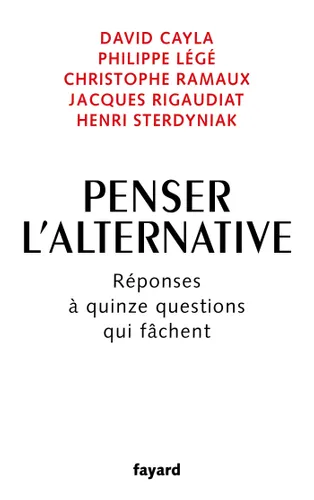
Comment expliquez-vous la montée du chômage en France au quatrième trimestre 2024?
La France est au bord de la récession. Sur l’ensemble de l’année dernière, on est à 1,1% de croissance du PIB, mais celui-ci a baissé au quatrième trimestre 2024. En Allemagne, c’est la récession depuis deux ans. On passe d’une situation d’enlisement à l’œuvre depuis au moins deux ans, à un risque très marqué de récession.
La question qui se pose, c’est pourquoi. Pour les keynésiens, dont je fais partie, c’est parce que la demande n’est pas au rendez-vous, or c’est elle qui tire l’activité. Les données de France Travail, indiquent une forte hausse du chômage au quatrième trimestre, la plus importante hausse depuis 2008.
On a un peu plus de 3 millions de personnes considérées comme chômeurs, au sens de France Travail. À savoir la catégorie A des demandeurs d’emploi, à savoir les personnes à la recherche d’un emploi, disponible immédiatement et n’ayant pas travaillé dans le mois précédent. Mais il faut y ajouter les catégories B et C, avec les demandeurs d’emploi qui ont travaillé respectivement moins et plus de 78h, soit plus de 2 millions de personnes. Puis on a les catégories D et E, soit environ 700.000 personnes, qui sont soit en formation (catégorie D) soit en emploi aidé ou en création d’entreprise (catégorie E). Au total, on a donc un peu plus de 6 millions de personnes inscrites à France Travail. Il ne faut décidément jamais oublier que le chiffre du chômage est très inférieur à celui du sous-emploi entendu au sens large (qui concerne aussi les temps partiels contraints). Cela vaut pour tous les pays du monde et cela vaut aussi en France pour l’autre chiffre du chômage (celui dit « officiel ») qui est donné par l’enquête emploi de l’INSEE.

Faut-il s’attendre à 100.000 emplois perdus en 2025, comme cela est annoncé dans la presse ces derniers jours, et si oui pour quelles raisons?
Il faut malheureusement s’attendre à cela. On a des défaillances record d’entreprises depuis plusieurs mois. Au moment du Covid, le nombre de faillites s’était réduit car l’État était intervenu via l’activité partielle et les aides aux entreprises. Les entreprises avaient gardé en leur sein une partie de main-d’œuvre « excédentaire », elles n’avaient pas réduit leurs effectifs à la hauteur de la baisse de leur production, heureusement d’ailleurs. Elles avaient une main-d’œuvre sous-utilisée qu’elles avaient gardée à la fois parce qu’elles étaient aidées, mais aussi parce que les chefs d’entreprise n’ont pas envie de se débarrasser de travailleurs dont ils sont satisfaits et sur lesquels ils peuvent compter en cas de reprise. Cela explique au passage la baisse de la productivité du travail observé depuis 2020.
L’activité est certes repartie au sortir du Covid, mais cette reprise a été, à bien des égards, insuffisante. On se retrouve donc dans une situation où des entreprises mal en point, en partie oxygénées par les aides publiques, font finalement faillite. Et à défaut de reprise suffisante, les autres recrutent moins. Les emplois temporaires sont en forte baisse. Or, ils sont souvent un indicateur avancé de conjoncture. Quand les entreprises embauchent, c’est d’abord sous forme de CDD ou d’intérim, pour sélectionner des candidats et par précaution en rapport à la pérennité de la reprise. Inversement, quand la situation se dégrade, elles se débarrassent d’abord des emplois temporaires ou elles ne les renouvellent pas. La baisse des effectifs dans l’intérim et les défaillances records attestent que l’économie française va décidément mal.
Ces nouvelles soulignent-elles les limites atteintes par la politique de l’offre, accentuée sous les deux mandats d’Emmanuel Macron, avec le projet sous-jacent d’une réindustrialisation de l’économie française?
La politique de l’offre, qui remonte en fait au tournant de la rigueur de 1983, est décidément un échec. Une des principales mesures prise par Macron depuis son arrivée au pouvoir en 2017 a été de baisser les prélèvements obligatoires. La baisse atteint plus de 70 milliards d’euros par an aujourd’hui, au bénéfice principalement des plus riches et des entreprises, qui souvent, leur appartiennent. Macron, à l’instar de Trump au cours de son premier mandat et de ce qu’il veut à nouveau faire, a baissé l’impôt sur le bénéfice des sociétés, qui est le moyen le plus direct et le plus efficace pour taxer les riches.
Quand on pense entreprise, on pense souvent aux PME. Mais il faut penser aussi aux grandes entreprises de plus de 5.000 salariés (30% des salariés du privé) et les ETI (plus de 20% des salariés), dont le capital est souvent détenu par une infime minorité. En France comme ailleurs, le capital est plus inégalement réparti que les revenus. Et au sein du capital, le capital financier, en particulier en actions, est bien plus concentré que l’immobilier. 80% des actions en France sont détenues par les 1% les plus riches. Macron a supprimé l’ISF, introduit la flat tax, baissé l’impôt sur les sociétés et certains impôts sur la production. Avec la promesse libérale que ces profits allaient permettre de relancer l’investissement de demain et de créer les emplois d’après-demain.

Résultat des courses: l’activité n’a pas rebondi. On est enlisés dans la stagnation et au bord de la récession. La très forte hausse du taux d’épargne des ménages illustre l’échec de cette politique. Le taux d’épargne des ménages est aujourd’hui de 3 à 4 points supérieur à ce qu’il était avant le Covid ! C’est la conséquence directe des cadeaux fiscaux faits aux plus aisés, puisque ce sont eux qui principalement ont les moyens d’épargner. Qui dit hausse de l’épargne, dit contraction de la consommation qui représente 80% de la demande globale (en y intégrant la consommation de services publics). Et cette contraction de la consommation entraîne celle de l’investissement des entreprises, lequel a baissé en volume en 2023 et 2024 !
Simultanément on observe un creusement du déficit public. Il ne s’explique pas par un surcroît de dépenses. Elles sont stables (en % du PIB) depuis 2017 ! Il s’explique par un défaut de recettes : le taux de prélèvements obligatoires à baissé de plus de 2 points de PIB depuis 2017. Et le système se boucle si l’on peut dire, mais de la pire façon : l’État a plus de déficit et de dette, il est donc contraint d’emprunter plus. Cela tombe bien, les riches ont plus d’épargne à placer grâce aux cadeaux fiscaux octroyés. Dit autrement, le déficit public dont on parle tant, renvoie aussi à cet excès d’épargne. Il ne peut jamais y avoir de dette sans créance !
Au final, la politique dite de l’offre, en fait au service du capital, n’est bonne ni pour l’activité et l’emploi, ni pour les comptes publics. Quel bilan calamiteux, en lieu et place de ce qu’un gouvernement au service de l’intérêt général devrait faire ! À savoir engager un vaste plan de reconstruction de notre économie, de notre société. Toutes sortes de besoins ne sont pas satisfaits en matière de justice sociale, de besoins alimentaires, de logement, de transition écologique. Le capitalisme néolibéral fait coexister chômage de masse et immense besoins insatisfaits. Quel gâchis ! Et de surcroît il fait passer dans le rouge les comptes publics, ce qui lui donne un argument pour continuer à privatiser.

Depuis le 1er janvier, la généralisation du droit au RSA sous condition de 15 heures de travail hebdomadaire est devenue effective. À quoi faut-il s’attendre comme effets produits, notamment sur le chômage en France ?
Jusqu’à présent, on avait cinq catégories de demandeurs d’emploi chez France Travail, de A à E, comme je l’ai évoqué précédemment. Deux nouvelles catégories, F et G, sont créées depuis janvier, afin d’enregistrer ceux des bénéficiaires du RSA qui n’étaient pas inscrits jusqu’alors à France Travail. La catégorie F, avec des demandeurs d’emploi en difficulté sociale et très éloignés de l’emploi et la catégorie G avec ceux en attente de réorientation. On va avoir donc avoir un gonflement des demandeurs d’emploi… mais pas nécessairement de ceux en catégorie A, les seuls à être reconnus comme chômeurs.
L’expérimentation qui a été faite dans plusieurs départements l’an dernier, montre que cela peut avoir du sens d’accompagner des bénéficiaires du RSA. Pas mal de bénéficiaires du RSA ont été très contents qu’il y ait des conseillers qui les appellent, pour faire un bilan, leur proposer un emploi ou une formation. On peut certes regretter le côté disciplinaire, stigmatisant, que peut prendre la réforme. Mais n’oublions pas que quand on a créé le RMI, il y avait l’idée de donner à la fois un droit à une rémunération minimale, ce qui est la moindre des choses, et aussi un droit à l’insertion.
Le danger avec la cure d’austérité en cours, c’est qu’on mette en place la généralisation du suivi des bénéficiaires du RSA sans les moyens. Et qu’ainsi, cela devienne seulement une contrainte administrative, pour réduire le nombre d’allocataires au RSA. Rappelons-le pourtant: le RSA coûte peu cher, de l’ordre de 15 milliards d’euros. Avec les allocations chômage, ils représentent moins de 10% des dépenses de protection sociale.
Quelles mesures seraient les plus pertinentes à lancer pour enrayer la désindustrialisation de l’économie française et atteindre l’objectif du plein-emploi selon vous?
Il faut bifurquer. On a un modèle économique, le néolibéralisme, qui s’est imposé depuis 40 ans et qui repose sur cinq volets : la finance libéralisée, le libre-échange, l’austérité salariale, la contre-révolution fiscale et la privatisation des entreprises publiques.
Pour satisfaire les besoins, répondre au défi écologique, aller vers le plein-emploi, il y a lieu de remettre en cause ces cinq volets. Mais de façon coopérante, car on ne peut pas toucher à un volet sans remettre aussi en cause les autres. On ne peut, par exemple, remettre en cause l’austérité salariale et la contre-révolution fiscale, si dans le même temps on ne remet pas en cause le libre-échange et la finance libéralisée. On n’a pas fait ce qu’il fallait après la crise de 2008.
Le libre-échange est certes en partie remis en cause. La Chine subventionne massivement son industrie depuis longtemps et cela a plutôt bien marché pour elle. Les États-Unis, à leur manière, remettent aussi en cause le libre-échange. Trump, le « méchant », l’a fait au cours de son premier mandat. Mais Biden, le « gentil », a approfondi cette politique protectionniste, en maintenant les droits de douane et en mettant des plans massifs de subventions comme l’Inflation Reduction Act, pour la relocalisation des activités industrielles. Il y a quelques années, à gauche, quand on parlait de protectionnisme, on s’exposait aux regards sombres de ceux qui passent leur énergie militante à traquer les supposés traîtres. Pour ces bien-pensants, protectionnisme = nationalisme = racisme. Le protectionnisme n’avait pas bonne presse, notamment dans des associations comme ATTAC. Cette dernière était altermondialiste, mondialiste donc en un sens, et rétive donc aux mesures de protection commerciale, sauf pour les paysans avec la « souveraineté alimentaire ». L’air du temps a heureusement changé. Le protectionnisme n’est plus un gros mot, y compris à gauche.

La finance exige des entreprises une rentabilité exorbitante, n’hésitant pas à fermer, supprimer, des activités rentables, mais insuffisamment en termes de rentabilité actionnariale. Il faut remettre en cause cette finance libéralisée de même que le libre-échange, de façon à pouvoir porter l’amélioration de la condition salariale, en particulier pour les bas et moyens salaires. Cela permettra à la consommation de repartir.
Simultanément, pour financer les investissements publics colossaux que nécessite la transition écologique, il convient de revenir sur la contre-révolution fiscale, réorienter les impôts sur les entreprises et les plus riches. Le gouvernement de droite de Bayrou, après celui de Barnier, admet qu’il convient de ré-augmenter les impôts sur les grandes entreprises et sur les plus riches et de réduire les exonérations de cotisations sociales. Il le fait de façon bien trop insuffisante. Mais il faut s’en réjouir en un sens : quel aveu d’échec !
Propos recueillis par Jonathan Baudoin
Christophe Ramaux est économiste, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et membre du collectif Les Économistes Atterrés. Il est également l’auteur de: Penser l’alternative (avec David Cayla, Philippe Légé, Jacques Rigaudiat, Henri Sterdyniak, Fayard, 2024), Pour une économie républicaine (De Boeck, 2022) L’État social. Pour sortir du chaos néolibéral (Fayard, 2012), Emploi : Éloge de la stabilité. L’État social contre la flexicurité (Fayard, 2006)

