L’année 2026 marquera le triste centième anniversaire de l’incarcération du philosophe italien Antonio Gramsci. Journaliste et acteur des grèves et occupations d’usine du biennio rosso, Gramsci a cofondé le puissant Parti communiste italien (PCI). C’était un penseur prolifique, pour qui il était inconcevable de séparer théorie et action. Quatre ans après la marche sur Rome, son militantisme et la force de ses idées lui valurent arrestation et emprisonnement au long cours. En novembre 1926, alors que les « lois fascistissimes » avaient déjà consolidé le caractère autoritaire du régime, le Conseil des ministres italien prend prétexte d’une supposée tentative d’assassinat contre Benito Mussolini par un adolescent de 15 ans pour prononcer une série de mesures d’urgence qui rendent les forces d’opposition hors-la-loi. Les prérogatives du Parlement désormais réduites à néant, les autorités font fi de l’immunité parlementaire du député communiste Gramsci, qui est arrêté et condamné en 1928 à deux décennies de réclusion, le procureur rapportant le souhait du Duce « d’empêcher ce cerveau de fonctionner pendant vingt ans ».

Fort heureusement, rien n’en fût. Malgré la dureté de son incarcération et un accès aux sources limité, Gramsci écrivit jusqu’à sa mort en 1937 un véritable chef d’œuvre aux visées tant analytiques que stratégiques, les fameux « Cahiers de prison ». Fragmentaires, souvent opaques pour échapper à la censure, ces écrits comptent parmi les pages les plus fertiles de la philosophie politique du XXème siècle. Gramsci y développe les notions clés qui continuent de nous aider à comprendre le champ du pouvoir : en premier lieu la construction permanente de l’hégémonie et du sens commun, mais aussi son corollaire imparfait, la révolution passive, une forme de domination qui repose sur des méthodes d’absorption plus ou moins coercitives de la dissidence que sont le transformisme et le césarisme. Sur le plan stratégique, il distinguait la guerre de mouvement, qui permit aux bolchéviques d’avoir raison d’un régime tsariste excessivement centralisé, et la guerre de position, seule à même de déjouer les tranchées et fortifications bien plus robustes derrière lesquelles se tapit l’appareil d’État capitaliste industrialisé. Ses réflexions sur le rôle des intellectuels et de la culture dans le combat politique sont d’une actualité saisissante, alors qu’une propagande rance s’abat sans coup férir sur la plupart des antennes hexagonales, et de manière toujours plus marquée dans le secteur de l’édition.
Au-delà de ses fulgurances théoriques, Antonio Gramsci est un personnage éminemment attachant. D’extraction très modeste, il s’est illustré par une grande combativité en dépit d’une santé extrêmement fragile. Il s’est aussi distingué par une puissante empathie qui le fit toujours prendre le parti des subalternes et des opprimés, et par une obstination intellectuelle que des conditions de détention difficiles n’ont jamais entamée. Sur le plan de l’éthique comme des idées, il se situe exactement aux antipodes du triste sire qui se présente désormais comme l’Edmond Dantès du XXIème siècle. Par toutes les focales possibles, Nicolas Sarkozy représente l’anti-Gramsci.
Le projet hégémonique sarkozyste
Un siècle plus tard, le rapide succès de librairie de ce « Journal d’un prisonnier » (premier des ventes de livres politiques en France en ce mois de décembre 2025, NDLR) pourrait prêter à la farce si le contexte n’offrait pas tant de résonances avec l’Italie des années 1920, avec ces ralliements plus ou moins assumés des libéraux aux nationalistes sur fond d’une incessante démonisation des forces de gauche. Le livre « témoignage » de l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été publié aux éditions Fayard, propriété du milliardaire ultra-conservateur Vincent Bolloré, sur le yacht duquel le premier s’était, on s’en rappelle, « reposé » de sa campagne présidentielle il y a déjà bientôt près de vingt ans. Artisan de la brutalisation du débat public dans les années 2000, Sarkozy faisait montre d’un talent certain pour parler à un électorat large, mâtinant savamment des postures sécuritaires et xénophobes de mythologie méritocratique et d’odes au propriétarisme. Au-delà d’un discours aux accents populaires et de rapts sémantiques sur le côté gauche, ce sont surtout ses outrances identitaristes qui surent persuader une frange des électeurs d’extrême-droite de rallier momentanément la droite dite « traditionnelle ». Une prouesse stratégique cynique aux effets éphémères, qui eut néanmoins pour conséquence d’ancrer durablement le débat public sur la droite, variante française du great moving right show identifié par le sociologue britannique Stuart Hall aux prémices du Thatchérisme.[i] Relativement cohérent, le projet hégémonique sarkozyste (2007-2012) présentait toutes les caractéristiques de ce que Hall appelait le « populisme autoritaire » ; il a toutefois pâti des métastases de la crise financière et buté sur les tribulations corruptives de sa principale incarnation.

Faute de place, on ne pourra lister ici les innombrables scandales dans lesquels l’ex-président est impliqué. On se contentera de rappeler que c’est l’affaire du financement libyen de sa campagne de 2007 qui lui a valu ces cinq années de prison pour association de malfaiteurs. Nicolas Sarkozy n’a pour l’heure effectué que vingt jours de détention provisoire, ayant été remis en liberté sous contrôle judiciaire en attente de son procès en appel qui devrait commencer au printemps 2026. Bien qu’il se compare volontiers au capitaine Dreyfus, il a été définitivement condamné dans le cadre de deux autres cas d’atteintes graves à la probité : pour corruption et trafic d’influence dans l’Affaire dite des écoutes, et pour financement illégal de sa campagne électorale de 2012 dans le cadre du scandale Bygmalion. Comme le journaliste de Mediapart Fabrice Arfi le rappelait sur les ondes de France Culture, Sarkozy revient en politique à chaque fois que les affaires le rattrapent: il crée Les Républicains en 2014 pour échapper à l’affaire Bygmalion, sa candidature à la primaire de 2016 coïncide avec l’affaire des écoutes, et son rapprochement avec l’extrême droite vise aujourd’hui à éclipser la réalité de l’affaire libyenne.
La posture victimaire adoptée par l’Ivan Denissovitch de la Villa Montmorency (se lamentant du « gris » de la prison, détaillant son ascèse alimentaire et priant pour « avoir la force de porter la croix de cette injustice ») relève de la pitrerie. Il est indéniable que la situation de surpopulation carcérale en France (136%) est scandaleuse, des conditions de détention honteuses que dénonçait en 2023 sur QG Dominique Simonnot, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Mais s’arrêter sur ces lignes alors que son auteur est actuellement en train de faire du footing en Guadeloupe provoque un certain malaise. Bien plus préoccupantes en revanche sont les prises de position politiques auquel le livre sert de prétexte, et en particulier ces signaux de plus en plus explicites de Nicolas Sarkozy visant à rendre crédible une union des droites en vue des prochaines échéances électorales. En témoignent ces salutations affectueuses adressées à Sébastien Chenu et à Jordan Bardella, le dernier allant jusqu’à lui évoquer « Chirac dans sa jeunesse ». Plus explicite encore, la mention de ce coup de fil à Marine Le Pen, à qui il a assuré qu’il ne s’associerait pas à un éventuel « front républicain » contre le Rassemblement national, enterrant définitivement toute notion de cordon sanitaire. Fort de son influence, l’ex-Président soutient en outre dans ces pages que « le chemin de reconstruction de la droite ne pourra passer que par l’esprit de rassemblement le plus large possible, sans exclusive et sans anathème ».
On peut désormais s’interroger sur le nouveau projet hégémonique qui semble animer un Sarkozy cerné par les affaires : la construction d’un bloc historique réactionnaire, qui verrait potentiellement les lambeaux de la droite traditionnelle s’accrocher au vaisseau amiral Rassemblement national. Il y a quelques mois, c’était pourtant du côté d’Emmanuel Macron que lorgnait Nicolas Sarkozy, sans que celui-ci ne daigne répondre à ses sirènes. Aujourd’hui, le pari de Sarkozy est sans doute que le Rassemblement National au pouvoir lui sera davantage miséricordieux. La contrepartie cynique de ce pacte faustien: une porosité toujours plus grande au sein de ce magma qui court de (l’extrême) « centre » à l’extrême-droite.
L’acquiescement suffit souvent
La digue qui tenait encore fragilement entre droite dite traditionnelle et droite extrême serait-elle donc définitivement en train d’éclater ? Le patron des députés Les Républicains Laurent Wauquiez a, on le sait, appelé à l’organisation d’une primaire dans laquelle serait inclue Sarah Knafo (Reconquête!), députée européenne et compagne d’Éric Zemmour. Malgré la détestation mutuelle qui semble les animer, le discours du chef du parti Bruno Retailleau n’est pas sensiblement différent de celui du grand dadais du Puy-en-Velay. Le vendéen refuse une alliance entre partis, considérée comme une « tambouille », mais assure que l’union se fera « par le terrain », « dans les urnes », et surtout que « Le Rassemblement National appartient à l’arc républicain », contrairement, indique-t-il, à La France Insoumise. Que Les Républicains glissent collectivement vers la réaction n’a rien de très étonnant: la création de la « Droite populaire » sous l’UMP trahissait déjà une inclination à l’autoritarisme et à l’identitarisme qui a progressivement gangréné le parti. Seules quelques rares, courageuses figures continuent de s’opposer encore activement à cette dynamique funeste d’union des droites, à l’image de la vice-présidente de LR Florence Portelli (dont le père, Hugues, juriste et sénateur, fut l’un des premiers à s’intéresser sérieusement à Gramsci dans la France des années 1970).
Si l’on se tourne vers l’Italie de Gramsci, on constate que sur le plan intérieur, deux éléments primordiaux ont permis à Mussolini de consolider son régime dans la première moitié des années 1920 : l’extrême violence et la collusion avec les libéraux. Le biennio rosso provoqua des craintes irrationnelles parmi le patronat et la révolution russe toute récente pesait lourdement dans les esprits des possédants, si bien qu’un bloc anti-socialiste réunissant libéraux, nationalistes et conservateurs ne tarda pas à prendre appui sur l’offensive armée fasciste pour orchestrer un retour à l’ordre. De 1920 à 1922, les raids des squadristes ravagèrent les bastions socialistes du nord de la péninsule, dans des attaques éclairs qui firent des milliers de morts parmi les travailleurs et les syndicalistes. Ces épisodes de violence extrême servirent de prélude à la marche sur Rome. À la suite de la prise du pouvoir par Mussolini et ses sbires, les autorités décrétèrent des politiques d’austérité, mirent hors-la-loi les organisations syndicales non-fascistes et tolérèrent l’assassinat brutal des dissidents.

Malgré ces méthodes bien peu libérales, de très nombreux libéraux acquiescèrent, trop apeurés par la menace « des extrêmes », à savoir les clérico-fascistes, mais surtout les socialistes et les communistes. D’où le soutien franc d’éminents intellectuels libéraux au fascisme, tels Giovanni Gentile ou Luigi Einaudi, ou même, plus brièvement comme le verra plus bas, de Benedetto Croce. Terrifiés que l’idée même de propriété privée soit menacée par l’activisme ouvrier, échaudés par les manigances transformistes de ce (très) vieux briscard de premier ministre qu’était Giovanni Giolitti, ils appelaient à l’instauration d’un « État fort », moins parlementaire, plus fidèle à « l’esprit » et à l’élan du Risorgimento. Unis par la même volonté de favoriser les intérêts des industriels, propriétaires terriens et détenteurs de capitaux et d’étouffer toute dissidence socialisante, les libéraux ont vu dans le fascisme un moindre mal, un molosse qu’ils seraient facilement à même d’apprivoiser et de manipuler. Ainsi, « l’union » en bonne et due forme n’est pas toujours nécessaire pour faire advenir un régime autoritaire et anti-pluraliste : l’acquiescement suffit souvent. Nul besoin, donc, de ne rêver que de pouvoir comme Wauquiez, ou de n’être obsédé que par l’idée de sauver sa peau comme Sarko, pour être dupé par les forces politiques les plus putrides.
Il ne s’agit pas d’affirmer ici que tous les libéraux soutiennent sans ciller le fascisme, mais plutôt que l’anti-socialisme compulsif mène parfois à l’aveuglement. À cet égard, le cas de Benedetto Croce (1866-1952) est révélateur et mérite que l’on s’y arrête un instant. Philosophe libéral-conservateur très influent, Croce était l’authentique intellectuel organique de la bourgeoisie italienne. Fortement influencé par Hegel, portant un projet philosophique plaçant les questions esthétiques au cœur, il se disait mû par l’ambition de « liquider » le marxisme. Son nom revient très fréquemment dans les « Cahiers de Prison », et particulièrement dans le cahier numéro 10, qui lui est presque entièrement consacré. Gramsci entretient une relation intellectuelle ambiguë avec Croce, partagée entre respect et irritation, reconnaissant sa contribution à la pensée de l’époque tout en critiquant son idéalisme et l’étroitesse de sa conception de l’histoire. L’opposition est toutefois tranchée, Gramsci allant jusqu’à affirmer entreprendre une démarche intellectuelle « anti-Croce ». L’objection de Croce au marxisme semble avoir participé de son inertie initiale, si ce n’est de son soutien au mouvement fasciste, avant de finir par se ressaisir en 1925.
En dehors des communistes et de Gramsci, qui y voit une dangereuse organisation de masse de la petite bourgeoisie, le personnel politique italien perçoit le fascisme comme un groupement éphémère qui finira dilué par les logiques de compétition partisanes. Ainsi, le sénateur Croce vote la confiance au gouvernement de Mussolini en 1922 comme en 1924, croyant au bien-fondé des promesses d’autorité pour revigorer un régime libéral ankylosé. L’assassinat sauvage du député socialiste Giacomo Matteotti cette même année le fera chanceler dans son attentisme, mais son opposition véritable ne prendra forme qu’en 1925, lorsqu’il publiera dans Il Mondo le fameux « Manifeste des intellectuels antifascistes » en réponse au « Manifeste des intellectuels fascistes » publié un mois plus tôt par Giovanni Gentile dans Il Popolo d’Italia. Cette prise de position valut quelques tourments à Croce ; rien de comparable toutefois au sort que subira Gramsci. Stefan Zweig brosse dans « Le Monde d’hier » un portrait touchant de son vieil ami, le décrivant claquemuré derrière le rempart de ses livres dans sa résidence napolitaine, continuant de s’exprimer sans masque et sans fard, sa retraite forcée ponctuée par les assauts des troupes de la réaction étudiante qui lui brisent ses fenêtres. Son manifeste eut un écho certain parmi la jeunesse, mais c’est bien en exil que se jouera le véritable antifascisme italien, et notamment en France.
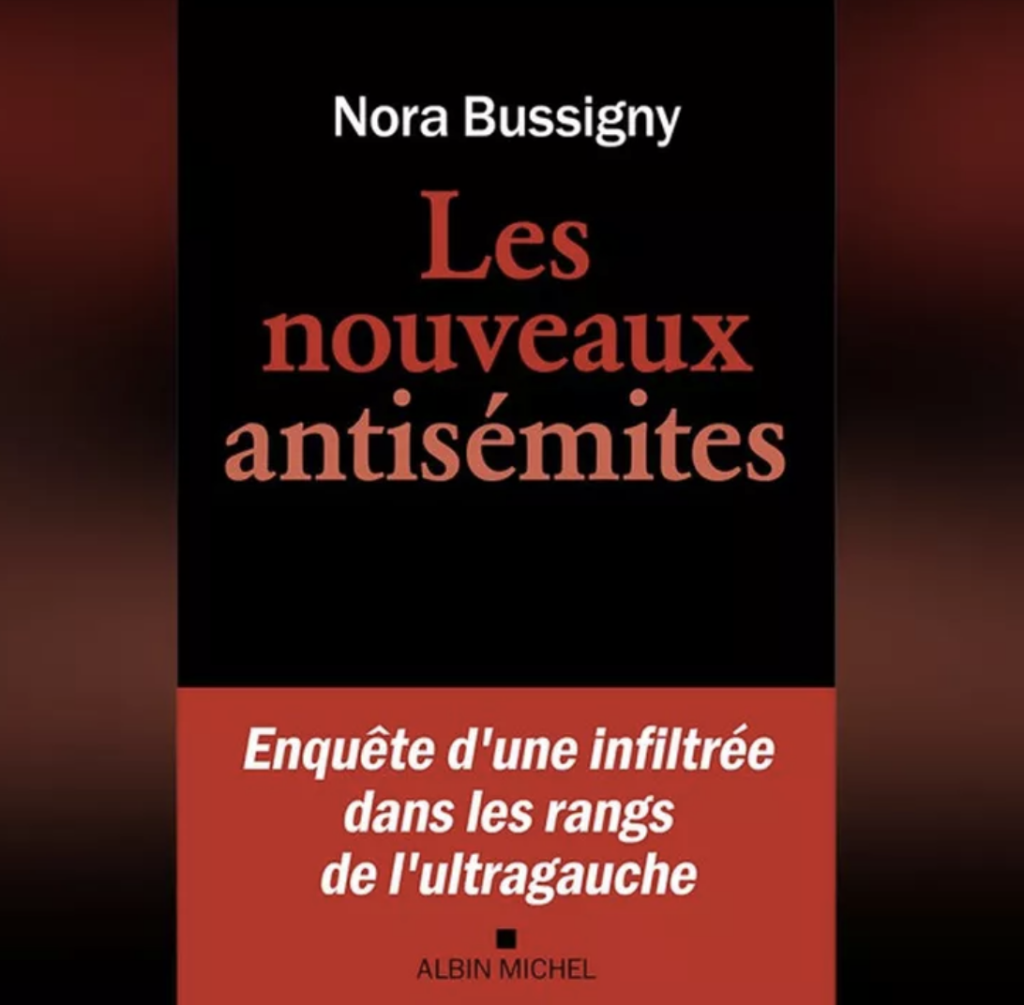
En somme, c’est donc, encore et toujours, la diabolisation des forces de gauche (en particulier l’accusation infamante d’antisémitisme) qui légitime ces coalitions plus ou moins tacites entre libéraux, conservateurs et extrême-droite. Certes, les forces de gauche françaises ne sont pas encore harcelées physiquement comme les italiennes ont pu l’être par les squadristes, mais l’extrême droite néofasciste agit de plus en plus à découvert (comme on a récemment pu le voir à Brest). Dans les régions, des alliances nauséabondes se constituent en vue des municipales pour faire obstacle à des socialistes très modérés, comme à Bourg-en-Bresse, où des élus Les Républicains se rangent sans vergogne sur la liste menée par le candidat Reconquête! Benoît de Boysson. La violence anti-prolétarienne se manifeste aujourd’hui de manière plus indirecte mais non moins redoutable, parfois de la main même des forces de l’ordre, qui s’autonomisent toujours davantage. Les appels aux forces armées pourraient également se multiplier dans les mois à venir : ultime pirouette césariste d’un pouvoir aux abois qui n’a que le mot « réarmement » aux lèvres ? L’une des leçons du Gramsci journaliste était que la discipline de l’action bourgeoise, qui sera par la suite celle du fascisme, repose sur l’obéissance militaire, comme le rappelle avec justesse Massimo Palma. Celle-ci « ne remet rien en question et accueille tout comme étant légitime dès lors que cela vient d’en haut ».
Pétrifiés par la montée en puissance des revendications ouvrières et par un prétendu « péril rouge », la majorité des forces de droite en Italie acquiescèrent à la prise de pouvoir par les fascistes, considérée comme un moindre mal dans un contexte qui rappelle cruellement la conjoncture française : austérité et autoritarisme parlementaire, sur fond de déclassement et de paupérisation généralisée, et de tensions géopolitiques majeures. Avec l’indécence et le cynisme qu’on lui connaît, Nicolas Sarkozy contribue ainsi de manière significative à cette dérive accélérée du capitalisme vers des structures ouvertement autoritaires, et renforce l’engeance qu’a inlassablement combattue Gramsci depuis les geôles dont il n’a, lui, pas réchappé.
Thibault Biscahie
Chercheur au Centre de recherche en droit public (Université de Montréal), Thibault Biscahie est un collaborateur régulier de QG
[i] Stuart Hall (1979). The Great Moving Right Show. Marxism Today, volume 23, pp. 14-20.
Crédit photo d’ouverture : MAGALI COHEN / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

